Olga
Воскресенье, 11 Июнь 2023 18:25
Книжные новинки. Лето, 2023. Художественная литература, зарубежный детектив
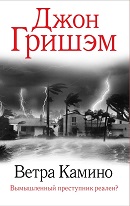
84(7Сое)-445.7
Г859
ГРИШЭМ ДЖОН Ветра Камино : роман / Джон Гришэм ; перевод с английского А. Курышевой. - Москва : АСТ, 2022. - 348, [2] с. - (Гришэм: лучшее). - 16+. - ISBN 978-5-17-148384-5. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Брюс Кэйбл, знаменитый антиквар и владелец книжного магазина на острове Камино, вновь оказывается в центре опасного расследования.
Отказавшись покидать остров на время разрушительного урагана, Брюс одним из первых узнает о гибели своего друга – автора триллеров Нельсона Керра. Что это: несчастный случай или тонко спланированное убийство?
Пока полиция вынуждена разбираться с последствиями стихии, Брюс задается вопросом, могут ли подозрительные персонажи романов Нельсона быть скорее реальными, нежели вымышленными. А где-то на компьютере погибшего хранится рукопись его последнего романа. Быть может, ключ к тайне прячется именно здесь — между строк? Брюс начинает расследование, и то, что он обнаруживает, шокирует куда больше, чем самый остросюжетный триллер.

84(4Вел)-44
М287
МАРРС ДЖОН Последняя жертва / Джон Маррс ; [перевод с английского М. В. Смирновой]. - Москва : Эксмо, 2022. - 349, [1] с. - (Альфа-триллер). - 16+. - ISBN 978-5-04-167024-5. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Одну жертву убийца парализовал прямо на переполненной платформе метро в час пик - и сбросил под поезд. Вторую утопил в алкоголе. И это только начало. Каждое убийство экзотично и не повторяет другие. Кажется, между ними нет связи. Но она есть.
Для детектива Бекки Винсент это расследование может стать скачком в карьере. Требуется "самая малость": найти нужное лицо среди моря лиц на камерах подземки. Бекка обращается к Джо Расселу из полуофициального отдела лондонской полиции, сотрудники которого известны как супер-распознаватели. Их феноменальная память содержит огромную базу лиц разных людей, позволяет проводить распознавание эффективнее компьютера и выстраивать недоступные обычному человеку цепочки ассоциаций. Рассел включает свои уникальные способности на полную.
Но время не на их стороне. Убийца вычеркивает из своего списка все новые и новые имена, действуя по лишь одному ему ведомой логике. Как найти связь между жертвами, пока он не добрался до последней из них?

84(4Вел)-44
М287
МАРРС ДЖОН Тьма между нами / Джон Маррс ; [перевод с английского К. И. Карповой]. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. - (Альфа-триллер). - 16+. - ISBN 978-5-04-122686-2. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Вы когда-нибудь злились на родителей за то, что они бесцеремонно лезут в ваши дела? Или думали, что помогаете своим детям, хотя на самом деле портили им жизнь? Вот к чему это иногда приводит.
Кажется, расплата Мэгги - ужасна. Кажется, ее вина перед дочерью Ниной - ужасна вдвойне. Тьма пролегла между ними. Каждые два дня женщины ужинают вместе. А потом дочь отводит Мэгги на чердак, в "воронье гнездо", и приковывает цепью к полу. Это - возмездие. Мать сделала то, чего дочь ей никогда не простит. Ни-ко-гда. Пусть до смерти гниет в этой темной каморке с глухими стенами и небьющимися окнами, с тяжелой цепью на лодыжке. Столь велика ненависть дочери.
Но есть то, чего Нина не знает. И мать никогда не расскажет ей - даже ценой своей жизни. Ведь в их доме правда опаснее лжи.
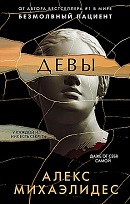
84(4Вел)-445.7
М694
МИХАЭЛИДЕС АЛЕКС Девы / Алекс Михаэлидес ; перевод с английского Е. М. Пальвановой. - Москва : Эксмо, 2021. - 347, [2] с. - 16+. - ISBN 978-5-04-122688-6. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Эдвард Фоска - убийца. В этом Мариана уверена. Харизматичный красавец-профессор преподает курс греческой трагедии в Кембридже. Его обожают коллеги и студенты - особенно студентки из тайного общества "Девы", готовые на все ради своего наставника. Ведомые мистическими учениями профессора, девушки устраивают оккультные игрища и ритуальные обряды. И вскоре, одну из них находят мертвой с перерезанным горлом и выколотыми глазами.
Мариана Андрос - талантливый психотерапевт с посттравматической депрессией из-за гибели мужа. Она ясно видит: Эдвард Фоска - нарциссичный социопат, умело манипулирующий людьми. Есть что-то зловещее в его одержимости культом Персефоны, спустившейся, согласно мифу, в царство мертвых. И смерть студентки - буквальное воплощение путешествия богини-девы в загробный мир. Эдвард Фоска - убийца. Осталось это доказать.

84(4Нор)-445.7
Н55
НЕСБЕ Ю Ревность и другие истории / Ю Несбё ; перевод с норвежского Дарьи Гоголевой, Анастасии Наумовой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2022. - 285, [2] с. - (Звезды мирового детектива). - Содерж.: Лондон; Очередь; Мусор; Признание; Одд; Сережка. - 16+. - ISBN 978-5-389-19081-8. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Сборник криминальных историй, объединенных темой ревности: чувства древнего, сильного, болезненного, неподвластного воле, изменяющего человеческую природу.
Двое знакомятся в самолете. Она рассказывает, что хотела умереть из-за измены мужа и подписала договор с компанией, инсценирующей самоубийства. Если бы женщина знала, кто сидит в соседнем кресле...
На греческом острове пропал турист, и для расследования приглашен детектив, обладающий уникальной способностью распознавать ревность при допросе... Подозрение падает на брата пропавшего человека.
Ревность прикрывается жаждой справедливости, сводит с ума, отравляет жизнь и меняет ее к лучшему лишь в том случае, когда соперника удается в прямом и переносном смысле убрать.

84(4Нор)-445.7
Н55
НЕСБЕ Ю Спаситель : роман / Ю Несбё ; перевод с норвежского Нины Федоровой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 477, [1] с. - (Звезды мирового детектива). - 16+. - ISBN 978-5-389-12869-9. - Текст : непосредственный.
КХ; ХЛ;
Пытаясь заглушить тоску по Ракели, Харри Холе с головой погружается в работу. Теперь он совсем один: коллеги его не любят, старый начальник ушел, а новый превыше всего ставит дисциплину. В этом Харри не силен, зато он здорово расследует убийства. В Осло появился международный киллер, на благотворительном концерте застрелен солдат Армии спасения. Чтобы разобраться в невероятно запутанном преступлении и по-своему восстановить справедливость, Харри должен раскрыть немало зловещих тайн.

84(7Сое)-445.7
О-573
ОМЕР МАЙК. Дом страха / Майк Омер ; перевод с английского А. Лисочкина. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 380, [2] с. - (Ток. Внутри убийцы. Триллеры о психологах-профайлерах). - 16+. - ISBN 978-5-04-166675-0. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Детектив Ханна Шор из Гленмор-Парка ведет дело о похищении дочери своей подруги. Чтобы вернуть девочку домой, она объединяет усилия с ФБР. Но даже матерые агенты Бюро в растерянности: похитители разместили требование выкупа и фото похищенной в социальной сети, и оно становится вирусным.
Ситуация быстро выходит из-под контроля. Теперь на детективов смотрит весь мир. Слухи распространяются со скоростью лесного пожара, а онлайн-линчеватели подливают масла в бушующее пламя. В городок со всей страны едут доморощенные сыщики. И начинается хаос.
Расследование заходит в тупик – похитители рассчитали все до мелочей и не оставили никаких следов. А время стремительно утекает. И тогда в Гленмор-Парк, отложив свое расследование в Техасе, приезжает профайлер ФБР Зои Бентли. Ее выводы становятся лучом света в кромешной тьме. Теперь детективы будут искать направленно. А главное, они поняли, что это похищение совершено не ради выкупа.

84(7Сое)-445.7
О-573
ОМЕР МАЙК. Сеть смерти / Майк Омер ; перевод с английского С. Г. Харитоновой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 316, [1] с. - (Ток. Внутри убийцы. Триллеры о психологах-профайлерах). - 16+. - ISBN 978-5-04-164198-6. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
В собственной квартире находят задушенной молодую женщину. Детектив Джейкоб Купер из полиции Гленмор-Парка выясняет, что жертва - отшельница, проводящая время в жестокой ролевой онлайн-игре - заблудилась в собственном виртуальном мире. Чтобы найти убийцу, Джейкобу придется самому вступить в эту игру…
В ту же ночь - и тоже на своей квартире - зарезан мужчина. Погибший был мерзким интернет-троллем, издевавшимся над женщинами в "Твиттере". И теперь детектив Ханна Шор, расследующая это дело, невольно спрашивает себя, так ли уж виноват его убийца…
Интернет… Всемирная паутина с множеством темных уголков, в которых поджидают своих жертв самые жестокие и злобные пауки. Джейкоб и Ханна лезут в эту сеть, не зная, что ждет их впереди…

84(4Вел)-445.7
П337
ПИРС САРА Скала Жнеца / Сара Пирс ; перевод с английского Н. Рокачевской. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2023. - 349, [1] с. - 16+. - ISBN 978-5-04-170790-3. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
На острове у побережья Англии открылся идиллический курорт, обещающий своим гостям первоклассный отдых и расслабление. Вот только у этого места, известного как Скала Жнеца, очень дурная слава. Несколько лет назад тут произошла серия жестоких убийств. Но что-то пошло не так.
Под павильоном для йоги находят мертвую девушку - кажется, она просто упала. Но детектив Элин Уорнер с удивлением узнает, что жертва вообще непонятно как оказалась на острове. Изначально девушка планировала отдохнуть здесь со своей семьей, но в последний момент планы поменялись, и они приехали без нее. И теперь им грозит смерть на Скале Жнеца.
Чем дольше Элин остается на острове, тем больше тайн ей открывается. А когда очередной гость тонет во время дайвинга, детектив понимает, что в этих смертях нет ничего случайного. Темная история острова повторяется.
Опасное и увлекательное детективное расследование на курорте, где убийцей может оказаться каждый.
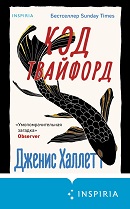
84(4Вел)-445.7
Х174
ХАЛЛЕТТ ДЖЕНИС Код Твайфорд / Дженис Халлетт ; перевод с английского А. Перекреста. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2023. - 347, [2] с. - (Tok. Детектив в кубе). - 16+. - ISBN 978-5-04-173517-3. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Когда-то Эдит Твайфорд была всемирно известной детской писательницей. Но сегодня единственное, что с ней ассоциируется, - это слухи о некоем таинственном коде. Говорят, в каждой ее книге спрятана часть зашифрованных подсказок, но никто не знает, куда они ведут. Сорок лет назад Стивен Смит нашел одну из книг Эдит Твайфорд со странными пометками и примечаниями. Он отнес ее своей учительнице, мисс Страль, которая была уверена, что пометки - ключ к разгадке головоломки. Внезапно мисс Страль загадочно исчезла, и Стив до сих пор не знает, жива ли она или ее убили. Теперь, выйдя из тюрьмы, он твердо намерен выяснить, что случилось в тот день и связано ли это с кодом.
Но Стив не единственный, кто идет по следу. Код Твайфорд таит секреты, ради которых многие готовы пойти на все. За разгадкой этой тайны столетия ведется настоящая гонка. Получится ли у вас раскрыть ее первыми?
Воскресенье, 11 Июнь 2023 18:22
Книжные новинки. Лето, 2023. Художественная литература, зарубежная проза

84(4Вел)-44
К985
КЭПЛИН ДЖУЛИ Уютная кондитерская в Париже / Джули Кэплин ; пер. с англ. Григория Крылова. - Москва : Эксмо, 2022. - 444, [1] с. - 16+. - ISBN 978-5-04-162487-3. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Романтическая история для поклонников Изабелль Брум, Элизабет Гилберт и Хелен Рольф.
Нина самая младшая в семье, поэтому каждый считает своим долгом дать ей совет и спасти от всех неприятностей в мире. Но девушке пора расправить крылья. У нее появляется уникальная возможность осуществить свою мечту: Себастьян, лучший друг ее брата, ищет помощницу, чтобы открыть кондитерскую в Париже. Вот только Нина когда-то была влюблена в Себастьяна. Смогут ли они работать вместе? Девушка решает рискнуть и собирает чемодан.

84(8Авс)-44
Л513
ЛЕСТЕР НАТАША. Швея из Парижа / Наташа Лестер ; пер. с англ. С. Селифоновой. - Москва : Эксмо, 2022. - 542 с. - 16+. - ISBN 978-5-04-123206-1. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Чем ты готова пожертвовать, чтобы о тебе узнал весь мир?
Французская швея. Британский шпион. Американская наследница. Эта история начинается в Париже и охватывает континенты и столетия.
Париж, 1940. Юная Эстелла Биссетт живет с матерью и работает в швейной мастерской. Она амбициозна, остра на язык, с детства изучает английский и мечтает стать великим модельером. Когда немецкие войска приближаются к Парижу, мать Эстеллы просит дочь уехать в Америку, к отцу, которого девушка никогда не знала. И на последнем пароходе Эстелла Биссетт уплывает в новую жизнь...
Нью-Йорк, 2015. Фабьен прилетает из Австралии на выставку легендарной линии одежды своей бабушки. "Если бы только Эстелла могла увидеть все это…"
Фабьен знакомится с ведущим дизайнером "Тиффани" Уиллом Огилви, с которым встретится вновь уже в Париже.
Узнав больше о прошлом бабушки, Фабьен откроет удивительная история потерь и обретений, разбитых сердец и исцеляющей силы любви.

84(7Кан)-44
М231
МАНДЕЛ ЭМИЛИ СЕНТ-ДЖОН Море спокойствия / Эмили Сент-Джон Мандел ; пер. с англ. Арама Оганяна. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 253, [1] с. - 16+. - ISBN 978-5-04-162308-1. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Меланхоличная сказка о разрушении привычного мира, путешествиях во времени и одиночестве.
1912 год. Восемнадцатилетний Эдвин Сент-Эндрю за ужином ссорится с отцом, после чего сбегает в Канаду.
1994 год. Двенадцатилетняя Винсент снимает загадочное видео в лесу недалеко от своего дома.
2020 год. После смерти Винсент, ее брат, ставший композитором, показывает это видео на своем концерте.
2203 год. Писательница Оливия Ллевеллин оставляет мужа и дочь дома, во второй лунной колонии, чтобы отправиться на Землю для книжного тура – она написала роман о пандемии.
Чтобы выяснить, как связаны эти люди и почему они слышат одни и те же звуки скрипки, детектив Гаспери-Жак Робертс должен отправиться в путешествие во времени. Но что если их реальность – это симуляция?

84(4Вел)-44
М292
МАРТИН САЛЛИ ЭНН Клиника / Салли Энн Мартин ; пер. с англ. В. Н. Тулаева. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2023. - 381, [1] с. - (Tok. Пациент. Психиатрический триллер). - 16+. - ISBN 978-5-04-169290-2. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Психиатрическая лечебница "Сосновый край" - огромный особняк посреди болот. Целый век здесь калечили людям психику, якобы борясь с их безумием. Все закончилось неистовым бунтом пациентов и убийством смотрительницы. Теперь в здании разместилась клиника "К прекрасной себе" - последняя надежда для женщин, отчаявшихся похудеть.
Дженни - одна из жертв "Соснового края". Много лет она провела в стенах этого садистского заведения и до сих пор не может прийти в себя. Но когда ее арендодатель решает присвоить этот особняк, именно Дженни предлагается проникнуть туда и собрать компромат на хозяйку нового заведения. Девушка не может отказаться - слишком соблазнительна сумма вознаграждения для той, кто едва сводит концы с концами.
Бывшая узница психбольницы с содроганием возвращается в место своих мучений. Но находит совсем не то, за чем ее послали: нынешняя клиника хранит тайну посерьезнее каких бы то ни было махинаций. Смертельную тайну…

84(4Ита)-44
М869
МОЧЧИА ФЕДЕРИКО Прости за любовь : [роман] / Федерико Моччиа ; [пер. с ит. Н. Колесова]. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 463, [1] с. - (Три метра над небом). - 16+. - ISBN 978-5-386-14145-5. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Алессандро тридцать семь лет, он успешен и богат, но личная жизнь не ладится. От него ушла любимая женщина, и мужчина тяжело переносит разрыв. Но однажды он на своем "мерседесе" сбивает скутер и таким образом знакомится с Ники, веселой и беззаботной семнадцатилетней девушкой. С этого момента их жизнь уже никогда не будет прежней.

84(4Ита)-44
М869
МОЧЧИА ФЕДЕРИКО Прости, но я хочу на тебе жениться / Федерико Моччиа ; пер. с ит. Я. А. Богдановой. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 590, [1] с. - (Прости за любовь). - 16+. - ISBN 978-5-386-14014-4. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Алекс и Ники, влюбленные друг в друга больше, чем когда бы то ни было, возвращаются из незабываемого романтического путешествия. Ники находит своих друзей: они повзрослели, а их жизнь наполнилась новыми обязательствами. Алекс возвращается к своей прежней жизни: работа в офисе, футбол и старые товарищи. Однако его друзья, безмятежные и уверенные в себе мужчины, сталкиваются с неожиданными трудностями, которые разрушают их брак. У героев возникает вопрос: Может ли любовь длиться больше трех лет? Алекс, романтик и мечтатель, решает рискнуть.

84(4Ита)-44
М869
МОЧЧИА ФЕДЕРИКО Тысяча ночей без тебя / Федерико Моччиа ; пер. с ит. П. И. Артемьева. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 382, [1] с. - (Прости за любовь). - 18+. - ISBN 978-5-386-14530-9. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
София не может признаться самой себе, что сбежала от проблем: брака с Андреа, воспоминаний о Танкерди, неопределенности чувств и безумной тоски по музыке. Софии придется взглянуть правде в лицо. Пришла пора взять судьбу в свои руки. Девушка возвращается обратно в Рим, к мужу и дорогому сердцу творчеству. Ей предстоит заново открыть для себя многогранность любви. Но вернуться к нормальной жизни не так-то просто. Софию поджидает множество сюрпризов. Чего только стоит появление Танкреди! Он изменился, но не смог забыть своих чувств и теперь намерен добиться взаимности. Чем же закончится эта история? И чего желает сердце пианистки? Нам только предстоит узнать.

84(4Вел)-44
Р181
РАЙЛИ ЛЮСИНДА Оливковое дерево / Люсинда Райли ; перевод с английского И. Клигман. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 444, [1] с. - 16+. - ISBN 978-5-04-122865-1. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Есть поверье, что каждый, кто посетит Пандору, непременно влюбится.
Пандора - старинный дом на Кипре, который Хелена, профессиональная балерина, получила в наследство от крестного. В юности она провела там отпуск, который изменил ее жизнь и о котором она никогда не рассказывала близким.
Проходят годы, Хелена приезжает в особняк с мужем и сыном. Но дом не зря имеет такое название. Вернувшись, Хелена словно бы открывает Ящик Пандоры, что хранит все ее беды и секреты. Она вновь встречает свою первую любовь - и это грозит сломать всю ее жизнь. Более того, ее сын Алекс, кажется, в шаге от того, чтобы повторить судьбу матери. Хелене предстоит заново найти с ним общий язык и решить для себя, что в ее жизни верно, а что нет.

84(7Кан)-44
Р584
РОБСОН ДЖЕННИФЕР Платье королевы : [роман о королевской свадьбе и не только] / Дженнифер Робсон ; перевод с английского Светланы Торы. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 381, [1] с. - 16+. - ISBN 978-5-04-120729-8. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Лондон, 1947 год
Вторая Мировая война закончилась, мир пытается оправиться от трагедии. В Англии объявляют о блестящем событии - принцесса Елизавета станет супругой принца Филиппа. Талантливые вышивальщицы знаменитого ателье Нормана Хартнелла получают заказ на уникальный наряд, который войдет в историю как самое известное свадебное платье века.
Торонто, наши дни
Хизер Маккензи находит среди вещей покойной бабушки изысканную вышивку, которая напоминает ей о цветах на легендарном подвенечном Платье королевы Елизаветы II. Увлеченная этой загадкой, она погружается в уникальную историю талантливых женщин, создавших это платье.

84(5Азе)-44
С217
САФАРЛИ ЭЛЬЧИН Тут мой дом : роман / Эльчин Сафарли. - Москва : АСТ, 2023. - 315, [1] с. - (Бестселлеры Эльчина Сафарли). - 16+. - ISBN 978-5-17-152572-9. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Помнит ли город людей, которые прожили в нём всю жизнь?
Ежедневно ходили по его улицам, вдыхали его бриз, пыль и дым, боролись за его мир и целостность, опускали в его землю любимых людей и встречали объятиями новое поколение.
Знаю, что всех лиц не запомнить, что люди похожи на быстрое и бесконечное течение реки. Но верю, что город помнит тех, кто его любит, кто служит ему делом – они оставляют тут свои отпечатки.
"Тут мой дом" — это трогательная история о мужчине и женщине, рассказанная устами ребёнка. Пережив её, вы ощутите прилив душевных сил и поверите, что любовь реальна и достижима, даже если в прошлом скрываются тени трагичных событий и досадных обид.

84(7Сое)-44
С449
СКОТТ ЭММА Среди тысячи слов / Эмма Скотт ; перевод с английского Е. А. Сибуль. - Москва : Эксмо, Freedom, 2023. - 540, [2] с. - (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт). - 18+. - ISBN 978-5-04-109758-5. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Тьма накрыла Уиллоу, когда ей едва исполнилось семнадцать. Ей что-то подмешали в напиток на вечеринке, от той ночи остались лишь обрывки воспоминаний. Но и этого хватило, чтобы жизнь разлетелась на осколки. Больше не было веселой симпатичной девчонки, вместо нее появилась угрюмая и недовольная, пытающаяся пережить то, что с ней сделали.
Еще хуже становится, когда отец Уиллоу переезжает из Нью-Йорка в небольшой городок Хармони, штат Индиана. Оторванная от привычной среды, вынужденная сменить школу прямо посреди двенадцатого класса, девушка теряется под тяжестью своей тайны. Все меняет участие в любительской постановке "Гамлета". Неожиданно для себя Уиллоу получает роль Офелии, ведь на пробах она вложила в шекспировский текст всю свою боль. Именно "Гамлет" свел ее с Айзеком. Типичный плохой парень, по которому сохнут все девчонки, прятался в своих сценических образах от бесконечных семейных проблем. Единственная его мечта – сбежать из ненавистного дома в Голливуд или на Бродвей, навсегда покинув это богом забытое захолустье.
Никто не сыграет Гамлета лучше Айзека, никому не дано передать боль и безумие Офелии лучше Уиллоу. Каждый из них закрыл сердце на замок от всего мира. Но вскоре оба поймут, что слова Шекспира – отражение их душ. Смогут ли они исцелиться любовью? Или вынужденная разлука станет последней каплей в чаше страданий?

84(7Сое)-44
С449
СКОТТ ЭММА Стань моим завтра / Эмма Скотт ; перевод с английского А. Федотовой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2022. - 541, [1] с. - (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт). - 18+. - ISBN 978-5-04-112142-6. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Зельда – талантливая художница, мечтающая о том, чтобы ее графический роман заметило издательство. Девушка совершенно новая в городе, не имеющая в этом месте друзей, работы, денег.
Беккет – юноша, по глупости и безысходности совершивший преступление, которое испортило все его планы на будущее. Но страшнее всего не та тюрьма, где он находился два года, а та, в которую он себя загнал, утопая в вине и сожалении, пресекая любые мысли о возможности стать счастливым.
Смогут ли они обрести силы, чтобы жить дальше?

84(7Сое)-44
С711
СПАРКС НИКОЛАС Возвращение : роман / Николас Спаркс ; перевод с английского Л. Галушкиной. - Москва : АСТ, 2021. - 351 с. - (Спаркс: чудо любви). - 16+. - ISBN 978-5-17-135993-5. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Последние слова умирающего деда породили у Тревора Бенсона немало вопросов. Как и почему старик, много лет не покидавший крошечный южный городок Нью-Берн, вдруг оказался далеко от дома? Каких родственников просил найти? Вынужденный оставить работу военного хирурга из-за ранения, Бенсон отправляется в Нью-Берн в поисках ответов. Здесь его внезапно настигает любовь к загадочной красавице Натали Мастерсон. Но почему она то принимает его ухаживания, то отдаляется от него? Юг хранит множество тайн и очень не любит их раскрывать. Однако Тревор не намерен отступать. Ведь для него — это прежде всего возможность расстаться с прошлым и начать все с чистого листа.

84(7Сое)-44
С711
СПАРКС НИКОЛАС Дорогой Джон : роман / Николас Спаркс ; перевод с английского О. А. Мышаковой. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. - (Спаркс: чудо любви). - 16+. - ISBN 978-5-17-119463-5. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
"Дорогой Джон…" Так начинается письмо Саванны, которая, устав ждать любимого, вышла замуж за другого. Эти слова разбили сердце Джона. Он больше не верит женщинам. Он больше не верит в любовь. Но разве настоящие чувства умирают? Разве ошибку молодости можно считать предательством? Пройдут годы, Джон и Саванна встретятся вновь. И искра былого пламени, оставшаяся в его душе, разгорится новым пожаром. Поздно? Но разве для счастья бывает поздно?

84(7Сое)-44
С711
СПАРКС НИКОЛАС Желание : роман / Николас Спаркс ; перевод с английского У. Сапциной. - Москва : АСТ, 2022. - 414, [1] с. - (Спаркс: чудо любви). - 16+. - ISBN 978-5-17-147322-8. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
1995 год — год, изменивший для шестнадцатилетней Мэгги Доус все. Год, когда ей пришлось переехать в маленький тихий городишко на острове у берегов Северной Каролины. Год, когда она встретила не по годам мудрого юношу по имени Брайс Трикетт, не только подарившего ей то, что станет для нее профессией, призванием и смыслом существования, но и научившего понимать природу, окружающий мир и саму себя.
2019 год — год, когда на знаменитого на весь мир фотографа Мэгги Доус обрушивается страшный диагноз. Отчаянно борясь за жизнь, она принимает помощь молодого ассистента Марка Прайса, с каждым днем все сильнее с ним сближается — и рассказывает ему свою историю. Историю большой любви и большой трагедии.

84(7Сое)-44
С711
СПАРКС НИКОЛАС Каждый вдох : роман / Николас Спаркс ; перевод с английского О. А. Мышаковой. - Москва : АСТ, 2022. - 319 с. - (Спаркс: чудо любви). - 16+. - ISBN 978-5-17-114234-6. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Почему жизнь сталкивает людей? Как не пройти мимо "своего" человека? Насколько сильно случайная встреча способна изменить вашу жизнь?
Хоуп Андерсон и Тру Уоллс в одно и то же время оказались в городке Сансет-Бич, Северная Каролина. Хоуп приехала на свадьбу подруги, Тру - чтобы познакомиться с отцом, которого никогда не видел. Они на несколько дней поселились по соседству и поначалу не подозревали, что с этого момента их мир разделится на "до" и "после".
Двое людей полюбили друг друга мгновенно, почувствовали, что составляют две половинки единого целого. Но как сохранить это счастье, если у каждого давно своя жизнь, полная сложностей и проблем? Как выстраивать отношения, если вас разделяет океан? И какой сделать выбор, если для осуществления мечты одного, нужно пожертвовать мечтой другого?

84(7Сое)-44
С711
СПАРКС НИКОЛАС Чудо любви : роман / Николас Спаркс ; перевод с английского Н. Огиенко. - Москва : АСТ, 2021. - 351 с. - (Спаркс: чудо любви). - 16+. - ISBN 978-5-17-134430-6. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Известный американский журналист Джереми Марш не верит в чудеса и паранормальные явления — он специализируется на разоблачении "магов", "контактеров" и "медиумов". Поездка в маленький провинциальный городок, где по местному кладбищу якобы бродят привидения, для него лишь очередное редакционное задание.
Но именно там, в самом сердце Юга, Джереми переживает истинное чудо — любовь к необычной, мечтательной молодой женщине Лекси. Любовь полностью переворачивает жизнь Марша.
Но готов ли он все изменить и научиться верить не разуму, а сердцу? Готов ли поверить в Чудо любви?

84(7Сое)-44
У135
УАЙТ КАРЕН Девушка с Легар-стрит / Карен Уайт ; пер. с англ. А. Бушуева и Т. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2022. - 476, [2] с. - (Зарубежный романтический бестселлер). - Цикл романов "Tradd Street". Книга 2. - 16+. - ISBN 978-5-04-104943-0. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
После того как Мелани получила в наследство особняк, ей выпал шанс встретиться наконец со своей матерью Джинетт, оперной певицей, которая вернулась в город после тридцатилетнего отсутствия. Джинетт уверяет, что их вынужденная разлука - способ уберечь дочь. Но от чего?
По просьбе матери, Мелани, имеющая дар общаться с духами, вступает в контакт с опасным призраком, обитающим в старинном доме на Легар-стрит. На помощь ей приходят обаятельный писатель Джек и журналистка Ребекка, которая уж слишком заинтересована в паранормальных явлениях, происходящих в городе.

84(7Сое)-44
У135
УАЙТ КАРЕН Духи Рождества на Трэдд-стрит / Карен Уайт ; пер. с англ. Т. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2022. - 508, [1] с. - (Зарубежный романтический бестселлер). - Цикл романов "Tradd Street". Книга 6. - 16+. - ISBN 978-5-04-161766-0. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Накануне Рождества Мелани и Джеку очень не хватает праздничного настроения. Прямо в саду их дома идут раскопки старинной цистерны. Для города эта находка уникальная, но Мелани, наделенная даром медиума, беспокоится, что вмешательство живых растревожит призраков. Добавляют проблем еще и слухи, что во время раскопок могут найти драгоценности, привезенные когда-то в Америку из Франции самим маркизом де Лафайетом. Сокровищами желают завладеть не только ученые.
Это шестая книга цикла романов о медиуме Мелани из Чарльстона. Романы цикла можно читать по порядку или как самостоятельные истории.

84(7Сое)-44
У135
УАЙТ КАРЕН Когда я падаю во сне : [роман] / Карен Уайт ; перевод с английского Ю. Хохловой. - Москва : Эксмо, 2020. - 445, [1] с. - (Зарубежный романтический бестселлер). - 16+. - ISBN 978-5-04-103177-0. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
1951 год.
На берегу реки стоит покрытый мхом дуб, Древо Желаний, что издавна хранит чужие секреты. По легенде, если написать свое сокровенное желание на ленте и положить ее в дупло, то оно сбудется.
Три подруги - Маргарет, Битти и Сисси - решают испытать судьбу. Они загадывают желания, которые действительно начинают сбываться. Но совсем не так, как бы им хотелось.
Наши дни.
Ларкин возвращается в необитаемый, полуразрушенный после пожара дом, где она когда-то жила со своей матерью Айви и с Сисси, которая их обеих вырастила. Пытаясь понять, из-за чего начался пожар в доме, Ларкин окунается в тайны далекого прошлого, и это заставляет ее переосмыслить собственную жизнь и отношение к любимым.

84(7Сое)-44
У135
УАЙТ КАРЕН Колыбельная звезд : [роман] / Карен Уайт ; перевод с английского Е. Савиной. - Москва : Эксмо, 2022. - 379, [2] с. - (Зарубежный романтический бестселлер). - 16+. - ISBN 978-5-04-165631-7. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
"Колыбельная звезд" — романтичная история о тайнах прошлого, поиске себя и, конечно, о любви. Джиллиан Париш развелась с мужем после того, как ее брак зашел в тупик, как, впрочем, и отношения с родителями. С ней осталась лишь семилетняя дочь Грейс и малыш, который появится на свет только через несколько месяцев.
Собрав свои немногочисленные вещи и усадив в машину дочь и кота, Джиллиан отправляется в Полис-Айленд в Южной Каролине, в дом своей бабушки — единственного человека, воспоминания о котором даруют Джиллиан покой и радость.
Вместе с маленьким пляжным домиком к Джиллиан возвращаются и воспоминания о давно прошедших днях юности. Она вспоминает историю своей подруги Лорен, которая бесследно исчезла много лет назад. Многие тогда заподозрили в преступлении их общего друга Линка Ризинга. Джиллиан никогда не верила в это, и теперь ей выпал шанс разобраться с этими слухами. По удивительному стечению обстоятельств Линк в это время тоже приезжает в Полис-Айленд. Но далее история приобретает странный оборот. Маленькая Грейс заводит себе воображаемого друга — призрачную девочку по имени Лорен.

84(7Сое)-44
У135
УАЙТ КАРЕН Незнакомцы на Монтегю-стрит / Карен Уайт ; пер. с англ. А. Бушуева, Т. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2022. - 477, [1] с. - (Зарубежный романтический бестселлер). - Цикл романов "Tradd Street". Книга 3. - 16+. - ISBN 978-5-04-113639-0. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Жизнь Мелани стремительно меняется. С недавних пор в ее доме живет тринадцатилетняя Нола, дочь ее возлюбленного Джека, о существовании которой они оба узнали совсем недавно.
У Нолы есть искусно выполненный большой кукольный домик с фигурками обитателей - копия одного из городских старинных особняков. Поговаривают, в особняке, имеющем непростую историю, обитают призраки.
Мелани и Джек отправляются к хозяйке дома, чтобы разобраться в этих слухах, потому что с недавних пор Мелани и Нола получают от потусторонних сил загадочные и иногда довольные пугающие знаки.

84(7Сое)-44
У135
УАЙТ КАРЕН Ночь, когда огни погасли : [роман] / Карен Уайт ; перевод с английского А. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2021. - 541, [1] с. - (Зарубежный романтический бестселлер). - 16+. - ISBN 978-5-04-110250-0. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Если Мэрили Талбот Данлап что и усвоила за одиннадцать лет брака, так это простой факт: можно прожить с человеком целую вечность и при этом не понять, что он за человек. После измены мужа и мучительного развода Мэрили переезжает с двумя детьми – десятилетней Лили и малышом Колином – в небольшой и очень уютный город, где арендует коттедж у суровой женщины девяноста четырех лет по прозвищу Душка.
Мэрили быстро сближается с местными жителями. У нее появляется подруга и даже тайное увлечение – мужчина, регулярно навещающий Душку, давнишнюю знакомую его бабушки.
Все бы хорошо, но загадочный автор, что ведет городской блог "Правила игры", вдруг начинает публиковать в нем очень личные детали из жизни Мэрили. Пытаясь установить его личность, Мэрили попадает в причудливую ловушку.

84(7Сое)-44
У135
УАЙТ КАРЕН Особняк на Трэдд-стрит / Карен Уайт ; пер. с англ. В. Бушуева. - Москва : Эксмо, 2022. - 475, [3] с. - (Зарубежный романтический бестселлер). - Цикл романов "Tradd Street". Книга 1. - 16+. - ISBN 978-5-04-101418-6. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Мелани поражена. Ее случайное знакомство с загадочным мистером Вандерхорстом вылилось в то, что она получила от него в наследство целый особняк. Условия - прожить там год и отреставрировать, чтобы стать полноправной хозяйкой. Мелани не любит старинные дома. Она с детства обладает жутковатым даром видеть призраков, коих немало в городе. А уж в викторианских домах - и подавно.
Помощь ей предлагает заносчивый писатель Джек, который вызывает у Мелани то злость, то желание его поцеловать. Отныне они связаны общей тайной: шифром, который, спасибо дару Мелани, должен помочь им отыскать старинные бриллианты.
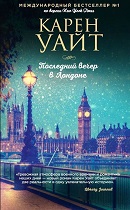
84(7Сое)-44
У135
УАЙТ КАРЕН Последний вечер в Лондоне : [роман] / Карен Уайт ; перевод с английского И. Миронова. - Москва : Эксмо, 2021. - 605, [1] с. - (Зарубежный романтический бестселлер). - 16+. - ISBN 978-5-04-122511-7. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Лондон, 1939 год
Ева и Прешес - амбициозные подруги, которые мечтают стать моделями.
Но военное время диктует свои законы, и девушки оказываются втянуты в сеть интриг, где шпионаж, предательство, дружба и любовь являются главными ставками в борьбе за мирное будущее.
Лондон, наши дни
Журналистка Мэдисон Уорнер собирается взять интервью у своей родственницы, бывшей модели Прешес Дюбо, и написать статью о моде в период Второй мировой войны.
Вместе со своим старым знакомым Колином, который когда-то был в нее влюблен, Мэдисон изучает письма и фотографии Прешес.
Это подводит ее к удивительному открытию, а также к мысли, что ей следует разыскать давнюю подругу Прешес, Еву, чья личность годами была окутана тайной.

84(7Сое)-44
У634
УОЛЛЕР РОБЕРТ ДЖЕЙМС Мосты округа Мэдисон / Роберт Джеймс Уоллер ; пер. с англ. Е. Г. Богдановой. - Москва : РИПОЛ классик, 2022. - 252, [2] с. - (Город женщин). - 16+. - ISBN 978-5-386-13931-5. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Давно разведённый, одинокий Роберт Кинкейд находит утешение в своей работе фотографа-международника. В 1965 году он едет на своём старом пикапе из своего дома в штате Вашингтон в Айову, чтобы сфотографировать крытые мосты для статьи в "National Geographic". Он находит шесть мостов, но седьмой, мост Розмана, ускользает от него. Он останавливается у фермерского дома, чтобы спросить дорогу, и знакомится с Франческой Джонсон, привлекательной домохозяйкой средних лет, которая осталась одна на неделю, а её муж и дети уехали на ярмарку штата. Её брак прочен, хотя и лишён любви, но что-то в высоком, жилистом незнакомце вдохновляет Франческу, и она сама предлагает показать ему мост.

84(4Вел)-445.7
Ф758
ФОЛИ ЛЮСИ Список гостей : [роман] / Люси Фоли ; перевод с английского А. Ардисламовой. - Москва : АСТ, 2022. - 382, [1] с. - (Объявлено убийство). - 16+. - ISBN 978-5-17-134260-9. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
На пустынном острове, затерянном в холодных водах, гости собираются, чтобы отметить радостное событие – свадьбу Уилла и Джулс. Шикарный особняк, возвышающийся над суровым пейзажем, распахнет свои двери только для избранных. Только для тех, кому повезло оказаться в списке гостей.
Жених – восходящая звезда экрана. Невеста – успешный издатель. Они молоды, амбициозны и вызывающе красивы. Торжество обещает быть грандиозным, правда, есть одно но… Обиды и ревность смешиваются с весельем, пожелания молодым перемежаются воспоминаниями. Но есть вещи, о которых лучше забыть. Каждому гостю есть что скрывать. Призраки прошлого блуждают по острову, и кто-то точно не доживет до конца свадьбы.

84(5Туц)-44
Ш30
ШАФАК ЭЛИФ Ученик архитектора : роман / Элиф Шафак ; пер. с англ. Екатерины Большелаповой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2022. - 636, [2] с. - (Азбука-бестселлер). - 16+. - ISBN 978-5-389-21406-4. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
XVI век. Османская империя. Эпоха Сулеймана Великолепного.
Волею судьбы двенадцатилетний Джахан и его подопечный, белый слоненок по кличке Чота, оказываются в Стамбуле, при дворе могущественного султана. Здесь Джахану суждено пережить множество удивительных приключений, обрести друзей, встретить любовь и стать учеником выдающегося зодчего - архитектора Синана.
Удивительный рассказ о свободе творчества, о схватке между наукой и фанатизмом, о столкновении любви и верности с грубой силой.

84(4Исп)-44
Э852
ЭСКОБАР МАРИО Колыбельная Аушвица : мы перестаем существовать, когда не остается никого, кто нас любит / Марио Эскобар ; пер. с англ. О. Перфильева. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2023. - 285, [1] с. - 16+. - ISBN 978-5-04-165380-4. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Хелен Ханнеманни и ее семья переезжают в Берлин в поисках лучшей жизни. В большом городе можно раствориться, а это лучший способ выжить в новой Германии - превратиться в невидимку. Но худшие опасения Хелен сбываются, когда ее мужа виртуоза-скрипача сначала увольняют из Берлинской консерватории, а после по приказу СС арестовывают вместе с их детьми. Потому что все они имеют цыганские корни.
Хотя Хелен немка и на нее не распространяется этот арест, она отказывается бросать семью. Несмотря на физическую и эмоциональную жестокость условий содержания в Аушвице, Хелен до последнего защищает детей, находящихся на ее попечении. Она сохраняет человеческое достоинство даже когда кажется, что вся надежда потеряна. В книге две концовки: художественная и реальная, каждый читатель сам решает, чем закончится история Хелен и ее семьи.
Воскресенье, 11 Июнь 2023 18:21
Книжные новинки. Лето, 2023. Художественная литература, военные приключения

84(2Рос=Рус)6-44
Г522
ГЛАДКИЙ ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ В архивах не значится : роман / Виталий Гладкий. - Москва : Вече, 2021. - 318, [1] с. - (Военные приключения). - 12+. - ISBN 978-5-4484-2679-7. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
"Поручик, распустив плетеный кожаный шнурок-завязку, вытряхнул содержимое мешочка на стол. И застыл, ошеломленный: на шершавых, нестроганых досках грубо сколоченного стола маслянисто желтели крупные золотые самородки..." Так в годы Гражданской войны началась эта история. Но ее участникам потребовалось пройти огненными дорогами Великой Отечественной и прожить десятилетия, чтобы приподнять укрывавший ее покров тайны.
Роман признанного мастера отечественной приключенческой и остросюжетной литературы.

84(2Рос=Рус)6-44
Д761
ДРУЖИНИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ Завтра будет поздно : повести / Владимир Дружинин. - Москва : Вече, 2021. - 255 с. - (Военные приключения). - Содерж.: Шкипер с "Ориноко". - 12+. - ISBN 978-5-4484-2858-6. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Необычна военная профессия героев повести "Завтра будет поздно". Это советские офицеры, работающие на "звуковке", их оружие - микрофон на переднем крае и листовки - слово правды, обращенное к врагу. А действие повести "Шкипер с "Ориноко"" происходит в начале войны, которая ныне известна как холодная. Избежавшие кары фашисты и их новые хозяева, которых интересует только прибыль, готовятся к новой кровавой схватке с Советским Союзом.

84(2Рос=Рус)6-44
И851
ИСАЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ Летчик под грифом "Секретно" / Вячеслав Исаев. - Москва : Эксмо, 2023. - 315, [2] с. - (Боевая хроника) (Романы о памятных боях). - 16+. - ISBN 978-5-04-174934-7. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Начало восьмидесятых. Военный летчик-инструктор капитан Алексей Шевцов командирован в Алжир для подготовки летного состава. Появление советского специалиста вызвало неподдельный интерес у местных военных. Особенно у тех, кто не слишком симпатизирует СССР. Кое-кто из подопечных прямо провоцирует капитана, но тот старается не реагировать на происки. Все резко меняется, когда Шевцов в паре со своим другом во время тренировочного полета якобы случайно оказывается над территорией сопредельного государства…
Стратегические планы, удачи и просчеты командования, коварство врага, подвиги солдат и командиров - война как она есть на самом деле. Подлинность событий нашей недавней истории.
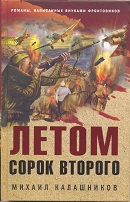
84(2Рос=Рус)6-44
К17
КАЛАШНИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ Летом сорок второго / Михаил Калашников. - Москва : Эксмо, 2022. - 317 с. - (Окопная правда Победы. Романы, написанные внуками фронтовиков). - 16+. - ISBN 978-5-04-169297-1. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
На основе реальных событий.
Исключительные по своей правде романы о Великой Отечественной. Грохот далеких разрывов, запах пороха, лязг гусениц – страшные приметы войны заново оживают на страницах книг, написанных внуками тех, кто в далеком 1945-м дошел до Берлина.
Июль 1942 года. Фронт катится к Дону. Тысячи беженцев и бойцов разрозненных советских частей скопились у переправы в районе села Белогорье. На том берегу – спасение гражданским, а военным – возможность отдохнуть и собраться с силами. Как назло, задерживает движение устроенная майором НКВД проверка документов. Необходимая формальность грозит страшной бедой – людскую лавину в любой момент могут атаковать немецкие бомбардировщики. Никто из столпившихся у переправы людей не знает, что еще накануне этот майор носил такое же звание… в фашистской армии.

84(2Рос=Рус)6-44
К56
КОВАЛЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ Диверсанты / Валерий Ковалев. - Санкт-Петербург : Крылов, 2022. - 318, [1] с. - (Библиотека "Мужского клуба"). - 16+. - ISBN 978-4-4226-0353-4. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Всё началось в 1940 году, когда на Балтфлоте отобрали молодых и сильных ребят, матросов и старшин, и приказом наркома ВМФ Кузнецова зачислили в Отряд специального назначения: морской диверсионный отряд боевых пловцов. Впереди была вся жизнь, и еще никто из них не знал, что будет дальше…
Это художественная книга, написанная по мемуарам Михаила Андреевича Усатова, чье имя хорошо известно в среде ветеранов и действующих сотрудников Федеральной Службы Безопасности России, чье имя вписано золотыми буквами в историю спецслужб страны. Книга о человеке, который прошел всю войну, начиная с самого первого дня. О человеке, который неоднократно забрасывался в глубокий тыл врага для выполнения особо важных заданий: уничтожения военных объектов, железнодорожных мостов, составов с живой силой и техникой, захвата "языков", сбора и передачи развединформации, который воевал на Курской дуге, форсировал Днепр, защищал Сталинград и освобождал Польшу. О человеке, который после войны возглавлял Особые отделы на Балтийском, а затем Северном Флоте, стал впоследствии одним из руководители Первого Главного Управления КГБ СССР (внешней разведки). О том, кто подготовил и осуществил десятки загранопераций, большинство из которых до настоящей поры остаются под грифом "Совершенно секретно".

84(2Рос=Рус)6-44
К642
КОНДРАТЬЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ Бомба для президента / Олег Кондратьев. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. - (Железная гвардия. Романы о президентском спецназе). - 16+. - ISBN 978-5-04-122947-4. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Из норвежской психиатрической больницы бежал опасный террорист по кличке Азер. Поиски преступника поручены специальной боевой группе Германа Талеева. Бойцы понимают, что этот побег - не случайный. Кто-то планирует использовать Азера для проведения масштабного теракта. Но где и когда он произойдет? Расследование приводит команду Талеева в один из северных городов, в порту которого полным ходом идет демонтаж реактора атомной субмарины. Похоже, смертельная акция намечена именно здесь. Опасения спецов усиливаются, когда становится известно о предстоящем визите в город президента России.

84(2Рос=Рус)6-44
О-31
ОВАЛОВ ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ Медная пуговица : роман / Лев Овалов. - Москва : Вече, 2022. - 350, [1] с. - (Военные приключения). - 12+. - ISBN 978-5-4484-3310-8. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Июнь 1941 года. На улицах Риги в самый канун войны на советского майора-штабиста Макарова совершено покушение. Он приходит в себя в немецком госпитале, где все почему-то считают его латышом обращаются к нему "господин Гешке". Дальше становится еще интереснее – некая загадочная дама, кстати, именно та, что стреляла в него, рассказывает ничего не понимающему майору, что "господин Гешке" это только прикрытие, под которым скрывается матерый английский разведчик Дэвис Блейк. Им-то Макарова все по какой-то ещё не ясной ему причине и считают. К майору проявляют интерес сразу три иностранные разведки. К счастью Макарова, попавшего в безвыходную ситуацию, удается установить контакт с хорошо законспирированным советским разведывательным подпольем, которым руководит легендарный майор Пронин...

84(2Рос=Рус)6-44
П425
ПОВОЛЯЕВ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ День отдыха на фронте : повесть, рассказы / Валерий Поволяев. - Москва : Вече, 2022. - 319 с. - (Военные приключения). - Содерж.: Городской воробей ; Визит в "конюшню" ; Екалеменэ по-гиндукушски. - 12+. - ISBN 978-5-4484-3741-0. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Великая Отечественная. Афганская. У разных поколений наших людей разные войны. Но подвиг всегда остается подвигом, даже если он внешне неброский. Для Вольта Суслова таким подвигом стали каждый день в осажденном врагами Ленинграде, а потом и служба в совсем уж необычной воинской части, для лейтенанта медслужбы Эдуарда Романюка — неожиданный рейд с группой разведчиков в горы Гиндукуша.

84(2Рос=Рус)6-44
П425
ПОВОЛЯЕВ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ Сталинградский гусь : роман, повесть / Валерий Поволяев. - Москва : Вече, 2021. - 255 с. - (Военные приключения). - Содерж.: Пыльная дорога в Пакистан. - 12+. - ISBN 978-5-4484-2678-0. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
"Пыхтя, как паровоз, Максимыч развернул пулемет и успел это сделать вовремя, поскольку на линию окопов вновь заходили "мессеры", а когда они приблизились, дал длинную очередь..."
"Душман целил в головную машину, но не учел скорости грузовика, вторая и третья машины также прошли без помех, пули лишь прошили воздух, а вот следующая пострадала — свинец снес половину кабины..."
Новые произведения признанного мастера отечественной военно-приключенческой литературы, лауреата Государственной премии Российской Федерации им. Г.К. Жукова, литературной премии "Во славу Отечества" и многих других.

84(2Рос=Рус)6-44
П425
ПОВОЛЯЕВ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ Южный крест : роман / Валерий Поволяев. - Москва : Вече, 2022. - 318, [1] с. - (Военные приключения). - 12+. - ISBN 978-5-4484-3299-6. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
В годы 1990-е, которые ныне принято называть "лихими", капитан Москалев получает предложение поработать в совместном российско-чилийском предприятии в далекой стране, на ночном небе которой главенствует Южный крест. Жаль не знает он, что жизнь стремительно меняется не только на "одной шестой суши", что отношение к представителям бывшего Советского Союза ухудшается повсеместно буквально не по дням, а по часам. Геннадий Москалев даже не подозревает, что поджидает членов его команды в Чили, через какие трудности и опасности придется им пройти.

84(2Рос=Рус)6-44
Т178
ТАМОНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ Багровый переворот / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. - (Спецназ КГБ). - 16+. - ISBN 978-5-04-161634-2. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Роман о напряженной работе специалистов уникального подразделения КГБ. От мозгового штурма при подготовке секретной операции до реальной схватки с коварным противником в любой точке земного шара - путь, который по силам только мужественным и преданным своему делу профессионалам.
Середина 60-х годов. В руководстве Болгарии назревает раскол. Часть правящей верхушки стремится к реставрации сталинизма, ей противостоят те, кто выступает за независимость страны от советской идеологии. Конфликт изо всех сил подогревает ЦРУ США. Болгарские спецслужбы знают точную дату переворота, но никак не могут нейтрализовать главарей заговора. На помощь коллегам отправляется группа "Дон" майора Вячеслава Богданова. Чтобы подобраться к зачинщикам, требуется время. Но болгарские силовики неожиданно начинают действовать раньше срока. Богданов и его бойцы оказываются в ситуации, когда нужно срочно менять план всей операции.
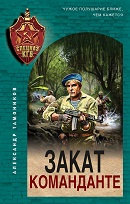
84(2Рос=Рус)6-44
Т178
ТАМОНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ Закат команданте / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [2] с. - (Спецназ КГБ). - 16+. - ISBN 978-5-04-169508-8. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
1967 год. Соратники революционера-романтика Эрнесто Че Гевары сталкиваются с жестоким сопротивлением боливийского режима. Чтобы держать на контроле действия команданте, КГБ внедряет в его окружение агента по кличке Таня. На какое-то время ситуация стабилизируется. Однако, агрессивно настроенные боливийские крестьяне выдают властям расположение кубинского отряда. Чтобы спасти Че и ценного агента Таню от неминуемой гибели, в Боливию направляется группа спецназа КГБ "Дон" майора Вячеслава Богданова. Бойцы еще не знают, что предстоящая задача намного сложнее, чем кажется: накануне отряд кубинцев разделился на части и "растворился" в лесах.

84(2Рос=Рус)6-44
Т178
ТАМОНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ Эхо северных скал / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2023. - 284, [2] с. - (Спецназ Берии). - 16+. - ISBN 978-5-04-172987-5. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Роман о военном времени, о сложных судьбах и опасной работе неизвестных героев, вошедших в ударный состав "спецназа Берии".
Фашисты планируют создать в советском Заполярье свои секретные морские базы. В случае удачи их субмарины станут серьезной угрозой нашему тылу. Группе майора Максима Шелестова поручено обследовать побережье и изучить имеющиеся сведения о возможном появлении там немцев. Максим выясняет, что фашисты действительно высаживались в указанном районе и даже успели составить подробную карту удобных бухт и фарватеров. Известно, что с ее помощью они в ближайшее время намереваются проникнуть на одну из советских баз и захватить топливо для своей лодки. Майор решает встретить "гостей" смертоносным сюрпризом.

84(2Рос=Рус)6-44
У762
УСОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ Дойти до перевала : роман / Александр Усовский. - Москва : Вече, 2022. - 286, [1] с. - (Военные приключения). - 12+. - ISBN 978-5-4484-3241-5. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Сентябрь 1944-го, самая страшная в истории человечества война приближается к закономерному финалу, но продолжает собирать кровавую жатву. В эти дни группа дальней разведки Генштаба РККА, которой командует капитан Савушкин, оказывается в охваченной пламенем восстания Словакии. Впереди у советских разведчиков смертельно опасные схватки с фашистами и их приспешниками, дерзкие диверсии, неожиданные встречи, обретение новых друзей и горькие утраты.
Воскресенье, 11 Июнь 2023 18:19
Книжные новинки. Лето, 2023. Техника

32.816
А364
АЙЛЕТТ РУТ Жизнь с роботами : что нужно знать каждому беспокоящемуся человеку / Рут Айлетт, Патрисия А. Варгас ; предисловие Ноэля Шарки ; пер. с англ. И. Д. Голыбиной. - Москва : АСТ, ОГИЗ, 2022. - 286 с. : ил. - (Будущее сегодня). - 12+. - ISBN 978-5-17-138916-1. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Вокруг роботов немало шума: часть информации кажется нам пугающей, а часть - утопической. Рут Айлет и Патрисия Варгас рассказывают историю взаимодействия человека с роботами - от чат-ботов и роботизированных протезов конечностей до беспилотных автомобилей и "роя" из множества маленьких роботов. Они демонстрируют, в чем роботы превосходят людей и в чем не могут равняться с нашими удивительными талантами. Авторы объясняют, как роботы видят, чувствуют, слышат, думают и учатся; описывают, как роботы могут сотрудничать с нами и между собой; оценивают их способности как дворецких, компаньонов и домашних питомцев. Наконец, они рассматривают связанные с ними этические и социальные проблемы: роботов-убийц, секс-роботов и роботов, способных отнять у вас работу.
"Жизнь с роботами" поможет читателю взглянуть на роботов непредвзято: как на рукотворные артефакты, а не предмет тревоги.

39.33г
Б466
БЕНТЛИ ДЖОН Автоутопия : [будущее машин] / Джон Бентли ; пер. с англ. Варвары Васильевой. - Москва : АСТ, ОГИЗ, 2021. - 253, [1] с. : ил. - (Разговоры о будущем). - 12+. - ISBN 978-5-17-120995-7. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Автомобили - едва ли не самое главное изобретение человечества после колеса. Они в корне изменили наши города и наши жизни, но в ближайшие 30 лет масштабные перемены ждут их самих. Так в каком же направлении пойдут технологии? Если Google отвоюет главное место на рынке, все мы будем сновать по дорогам в крошечных электромобилях, похожих на мыльные пузыри. Или же мы станем свидетелями гонок с участием роботов и бионических пилотов? И что же будет с классическими автомобилями?
На этих страницах автоэксперт Джон Бентли вспоминает славную историю автостроения и беседует с инженерами и программистами, которые навсегда меняют машины. То, что получилось, - это настольный справочник по будущим трансформациям нашего личного транспорта, от машин на водородном топливе до летающих моделей с реактивным двигателем.
Увлекательное чтение для всех, кто уверен, что шум мотора - не пустой звук.

30г
Д404
ДЖЕКСОН ТОМ Взламывая технологии / Том Джексон ; пер. с англ. А. Степановой. - Москва : АСТ, ОГИЗ, 2021. - 271 с. : ил. - (Взламывая науку). - 12+. - ISBN 978-5-17-134173-2. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Сложно представить, каким был бы мир без технологий. Уже первые из них - создание орудий из камня и приручение огня - сильно изменили жизнь людей, подарив им защиту и улучшив питание. Применение научных открытий позволило людям строить города, пересекать океаны, открывать новые земли, выращивать растения, освещать помещения, передвигаться по воздуху и под землей, быстро передавать информацию и многое другое. В этой книге собраны самые значимые идеи за всю историю человечества, которые смогли изменить мир и изменят его еще не раз.

30у
Д424
ДЖОНСОН СТИВЕН Изобрели телеграф, затем айфон : гениальные идеи, изменившие мир : перевод с английского / Стивен Джонсон. - Москва : АСТ, Время, 2023. - 199, [2] с. - (Интересный научпоп). - Библиогр.: с. 197-201. - 12+. - ISBN 978-5-17-144690-1. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Стивен Джонсон исследует многовековую историю инноваций от зарождения идей в головах любителей, дилетантов и предпринимателей до малопредсказуемого, но интересного влияния таких изобретений на наш современный мир.
Книга наполнена удивительными историями случайной гениальности и блестящих ошибок - от французского издателя, который изобрёл фонограф, но забыл его включить, до голливудской кинозвезды, повлиявшей на создание Wi-Fi и Bluetooth. "Изобрели телеграф, затем айфон: гениальные идеи, изменившие мир" открывает вам дверь в историю тайн обыкновенных предметов современной жизни.

16.6
И868
Искусственный интеллект : что стоит знать о наступающей эпохе разумных машин / авторы-составители: Элисон Джордж, Дуглас Хэвен ; пер. с англ. О. Д. Сайфудиновой. - Москва : АСТ, ОГИЗ, 2019. - 348 с. : ил. - (New Scientist. Лучшее от экспертов журнала). - 12+. - ISBN 978-5-17-115608-4. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Что такое искусственный интеллект и как его создать? Как машины учатся и обыгрывают людей? Могут ли они создавать произведения искусства? Как сверхразумные машины изменят наш мир? Неужели искусственный интеллект может привести к концу света?
Мы стоим на пороге больших технических и этических проблем, и эта книга расскажет вам всё самое важное об искусственном интеллекте. Здесь собраны лучшие статьи экспертов журнала New Scientist: мысли ведущих ученых, ответы на самые неожиданные вопросы и предсказания о том, какой будет наступающая эпоха разумных машин.

16.6
К447
КИССИНДЖЕР ГЕНРИ Искусственный разум и новая эра человечества : перевод с английского / Генри Киссинджер, Эрик Шмидт, Дэниел Хаттенлокер. - Москва : Альпина ПРО, 2022. - 198, [1] с. - 12+. - ISBN 978-5-907534-65-0. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Мы живем в мире, в котором искусственный интеллект фильтрует для нас огромные массивы онлайн-информации, меняя наше восприятие реальности, и внедряется в здравоохранение, образование и ряд других областей, в которых мы раньше доверяли только людям. Глубокие нейросети выигрывают у чемпионов мира по шахматам, обнаруживают новые лекарства способами, которых не понимают современные ученые, и побеждают опытных пилотов-людей в симуляциях воздушных боев. Как искусственный интеллект изменит роль человека в познании мира, современной политике и функционировании общества? Этому важнейшему вопросу современности и посвящена данная книга.

16.6
М676
МИТЧЕЛЛ МЕЛАНИ Идиот или гений : как работает и на что способен искусственный интеллект / Мелани Митчелл ; перевод с английского Заура Мамедьярова. - Москва : АСТ, Corpus, 2022. - 380, [1] с. : ил. - (Элементы 2.0) (Библиотека фонда "Династия"). - Книжные проекты Дмитрия Зимина. - 12+. - ISBN 978-5-17-127256-2. - Текст : непосредственный.
За 65 лет, прошедших после Дартмутского семинара, который положил начало разработке искусственного интеллекта, в этой области совершено множество прорывов, однако до создания машины с “человеческим” интеллектом по-прежнему далеко. Сегодня ИИ распознает изображения и переводит речь, управляет беспилотными автомобилями, обыгрывает человека в шахматы и го, но пока не способен переносить навыки на новые задачи, может перепутать соль с дорожной разметкой, а автобус — со страусом. Мелани Митчелл, одна из ведущих ученых-информатиков, знакомит читателя с историей развития ИИ и принципами его работы, рассказывает о главных проблемах его применения и перспективах создания ИИ “человеческого уровня”.

16.8
Р186
РАЙТМАН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ Старший брат следит за тобой : как защитить себя в цифровом мире / Михаил Райтман. - Москва : Альпина Паблишер, 2022. - 692, [1] с. - 16+. - ISBN 978-5-9614-7583-8. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Михаил Райтман – системный администратор, журналист, автор руководств по эксплуатации IT-технологий. В его библиографии – многочисленные рекомендации по работе с различными программами и другими информационными продуктами. В новой книге автор говорит о цифровой безопасности.
Жизнь современного человека неотрывно связана с гаджетами, современными технологиями, интернетом. Невозможно представить нашу повседневность без смартфона и компьютера. Повсюду нас окружают камеры, датчики, сканеры. Для нашего комфорта и безопасности создаются многочисленные "умные" девайсы и даже целые "умные" дома. Растет также и риск стать жертвой мошенников, которые могут получить доступ к нашим данным чуть ли не из тостера. Кто владеет информацией – владеет миром. Или вашими счетами, личными фото, секретами, которые вы предпочли бы держать подальше от посторонних. В своей книге Райтман рассказывает, как обезопасить себя в век всеобщей диджитализации и не попасть на крючок мошенников.
Простая и понятная инструкция по выживанию в современном мире технологий.
Действенные советы от настоящего профессионала, который знает IT-индустрию изнутри.
Рабочая схема защиты от цифровых угроз.
Прогноз на будущее, в котором аналоговый мир окончательно перестанет существовать.
Автор расскажет, как не впадать в крайности, как не стать технологическим затворником и обернуть возможные недостатки системы в свою пользу.

30у
С272
Сделано в России: идеи, технологии, открытия : книга для детей от 12 до 112 лет / автор-составитель Роман Фишман ; коллектив авторов: Айрат Багаутдинов, Юрий Грановский, Александр Грек и др. - Москва : АСТ, 2019. - 255 с. : ил. - (Популярная механика). - 12+. - ISBN 978-5-17-112453-3. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
"Популярная механика" ― это журнал о том, как устроен мир. Новый сборник избранных статей журнала призван помочь читателям по-новому взглянуть на происходящее вокруг, познакомить с технологиями, которые нас окружают, и теми, которые лишь разрабатываются, но уже обещают в корне изменить нашу жизнь. С блестящими идеями российских инженеров прошлого ― и удивительными задачами, которые с тем же упорством решают изобретатели сегодняшнего дня. Мы живем в удивительном мире и в не менее удивительной стране ― давайте же узнаем их получше.
Нам есть, чем гордиться! Фундаментальная наука и прикладная электротехника, авиация и телевидение, сверхпроводимость и даже искусственный интеллект – российские ученые, инженеры и разработчики уверенно выступают и далеко за пределами таких традиционно "наших" областей как военная техника и космонавтика. Современные беспилотники и небоскребы, новые двигатели и материалы продолжают традиции всемирно известных исследователей и изобретателей прошлого. Идеи, казавшиеся невозможными еще недавно, воплощаются – в России – уже сейчас.
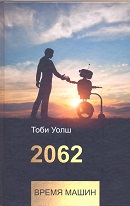
16.6
У636
УОЛШ ТОБИ 2062: время машин / Тоби Уолш ; перевод с английского А. И. Стрельцова. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. - (Технологии и бизнес). - Библиогр.: с. 304-305. - 16+. - ISBN 978-5-17-112828-9. - Текст : непосредственный.
2062 год — что это за дата? Ведущие эксперты по искусственному интеллекту и робототехнике предсказывают: в 2062 году мы сможем создать искусственный разум, который превзойдет возможности человека. Еще в начале 1990‑х Гарри Каспаров уверен, что «в классических шахматах на серьёзном уровне компьютерам ничего не светит в XX веке» ... и в 1997 году проигрывает компьютеру Deep Blue. А двадцать лет спустя AlphaGo выигрывает партию у лучшего в мире игрока в го. Что же нас ждет теперь? На этот вопрос отвечает Тоби Уолш, признанный специалист по искусственному интеллекту. В своей книге он внимательно и последовательно изучает каждую сторону нашего «светлого будущего»: от мировой экономики до новой человеческой идентичности. Уже поздно обсуждать, хорош или плох будет мир в этом очень недалеком будущем. Сейчас главное — понять, как к нему готовиться.
Воскресенье, 11 Июнь 2023 18:18
Книжные новинки. Лето, 2023. Тексты. Сценарии. Презентации

83
Б462
БЕНКЕ КАРЕН Пиши еще! : руководство для начинающего писателя : перевод с английского / Карен Бенке ; переводчик Виктор Генке. - 3-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2022. - 254 с. - Библиогр.: с. 247-249. - 0+. - ISBN 978-5-9614-6900-4. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Написать собственную книгу не так сложно, как кажется. Особенно если знать, какие приемы могут вам в этом помочь. Конечно, научиться творческому письму можно, потратив несколько лет и окончив литинститут. А можно прочитать книгу Карен Бенке. Конечно, она не сделает из вас Набокова или Толстого, но в ней вы найдете все для того, чтобы начать литературную деятельность.
Автор предлагает не зацикливаться на скучных академических правилах, а дать волю воображению, играть со словами, мыслеформами, рифмами, размерами и идеями. Небольшие разделы, каждый из которых посвящен конкретному творческому приему, состоят из краткой теоретической части, интересного задания, места для его выполнения и примеров того, как это можно сделать. В книге также есть ценные советы известных писателей начинающим.
Книга адресована в первую очередь юным читателям, но взрослые по всему миру уже оценили её по достоинству, и тоже с удовольствием читают и применяют полученные из книги знания.

77.056с.я92
Б872
БРАЙАНТ РОБЕРТ ДЕНТОН Убейте дракона! : как писать блестящие сценарии для видеоигр / Роберт Дентон Брайант, Кит Джильо ; перевод с английского О. И. Перфильева. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2022. - 256 с. - (Мировой компьютерный бестселлер. Гейм-дизайн). - 12+. - ISBN 978-5-04-157822-0. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Эта книга - ваш путеводитель в мир блестящих видеоигр. Авторы подробно объясняют механику успешных игровых продуктов, знакомят читателей с их сюжетами и на конкретных примерах показывают, как писать сценарии, которые понравятся всем. Вместе с голливудскими сценаристами вы шаг за шагом пройдете путь от зарождения идеи до реализации проекта. В этом вам помогут кейсы и практические упражнения, представленные в книге, а также профессиональные советы и рекомендации авторов.

83.3(7Сое)
Г47
ГИЛБЕРТ ЭЛИЗАБЕТ Большое волшебство : творчество без страха / Элизабет Гилберт ; перевод с английского Е. Я. Мигуновой. - Москва : РИПОЛ классик, 2022. - 318, [1] с. - 16+. - ISBN 978-5-386-10553-2. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Элизабет Гилберт - популярная американская писательница, автор всемирно известной книги "Есть, молиться, любить", продержавшейся 199 недель в списке бестселлеров The New York Times.
"Большое волшебство" - исследование на тему творчества: какова его природа, какую роль оно играет в нашей повседневной жизни, откуда берутся идеи, как преодолеть страх и начать творить.
По мнению автора, внутри каждого из нас таятся необычные сокровища, которыми нас наградила природа. И наша задача - вытащить их на свет. А что для этого нужно сделать, объяснит эта практичная книга, полная ярких примеров и удивительных открытий.

81.2Р-5
Г708
ГОРШЕЕВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ Я бы поправил : пошаговое руководство по редактированию текстов / Игорь Горшеев. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2023. - 172, [1] с. - (TEXT UP. Копирайтинг нового уровня). - 12+. - ISBN 978-5-04-160037-2. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Это универсальное пособие по редактированию текстов. Речь не о "жи-ши", а об ошибках, которые обычно допускают люди без филологического образования. Эта книга как воздух нужна копирайтерам, журналистам, СММ-специалистам, блогерам, писателям. Всем, кто много пишет и хочет, чтобы его тексты были сильные и грамотные.
Игорь Горшеев полностью разбирает процесс редакторской работы с материалом, от проверки логики до устранения стилистических ошибок. С помощью его книги начинающие авторы и редакторы выстроят правильный алгоритм работы с текстом, а опытные – закроют возможные пробелы.
Как писать доходчиво, аргументированно и без штампов.
Как, не жертвуя смыслом, делать текст ясным и логичным.
Как и где проверять правильность написанного.
Как облегчать восприятие текста с помощью оформления.

60.84
Ж454
ЖЕВНИКОВ ИЛЬЯ Чтобы читали и не ворчали : секреты отчетов и презентаций, с которыми приятно работать / Илья Жевников. - Москва : Эксмо, 2020. - 214 с. : ил. - 16+. - ISBN 978-5-04-105671-1. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Как сделать карьеру? Есть честный и надежный способ - профессионально предоставлять информацию коллегам и особенно руководителям. Писать четкие письма, делать убедительные презентации, готовить удобные отчеты. Это не так просто, придется стать "мастером на все руки": писателем, дизайнером, копирайтером и даже психологом. Книг по коммуникации, синтезирующих все эти знания в единое целое, просто нет. Вернее не было, пока не вышла эта.
Прочитав книгу, вы научитесь:
- делать ваши сообщения лаконичными и удобными для восприятия;
- создавать безупречно структурированные документы;
- вызывать доверие читателя;
- умело пользоваться графиками и диаграммами;
- привлекать внимание к своим сообщениям очень занятых людей.

83
З-635
ЗИНСЕР УИЛЬЯМ Как писать хорошо : классическое руководство по созданию нехудожественных текстов : перевод с английского / Уильям Зинсер ; переводчик В. Бабков. - 5-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 290 с. - Библиогр.: с. 287-290. - 0+. - ISBN 978-5-9614-6661-4. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Это практическое пособие, подходящее как для журналистов, так и для ученых. Она учит работе с текстом: подбору слов, построению предложений, устранению излишней цветистости или, наоборот, канцелярщины. Учит тому, как важно не только выбрать интересную тему, но и постараться раскрыть его понятно для читателя.

81
И49
ИЛЬЯХОВ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ Пиши, сокращай : как создавать сильный текст / Максим Ильяхов, Людмила Сарычева. - 3-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2021. - 439 с. : ил. - На обл.: Копирайтерам, дизайнерам, журналистам, менеджерам и всем, кто пишет по работе. - 12+. - ISBN 978-5-9614-6526-6. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Авторы на конкретных примерах показывают, что такое хорошо и что такое плохо в информационных, рекламных, журналистских и публицистических текстах. Как писать письма, на которые будут отвечать, и рассылки, от которых не будут отписываться. Как создавать действенные и не вульгарные рекламные объявления. Как излагать мысли кратко, ясно и убедительно: без языкового мусора, фальши и штампов. Следуя рекомендациям в книге, вы научитесь писать понятно, увлекать читателей и добиваться доверия. Это обязательная книга для копирайтеров, авторов и редакторов, а также дизайнеров, программистов, менеджеров, предпринимателей, руководителей, служащих и всех, кто использует текст в работе.

81
И49
ИЛЬЯХОВ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ. Ясно, понятно : как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов / Максим Ильяхов. - Москва : Альпина Паблишер, 2021. - 447 с. : ил. - Продолжение бестселлера "Пиши и сокращай". - 12+. - ISBN 978-5-9614-3582-5. - Текст : непосредственный.
КХ; ОЛ;
Эта книга о правильной и понятной коммуникации: как с помощью слов доносить свои мысли и влиять на людей.
Максим Ильяхов развивает тему, затронутую в бестселлере "Пиши, сокращай". Вы узнаете, как привлечь внимание читателей, как помочь им понять и принять точку зрения автора, как увлекательно и доступно раскрыть любую тему, даже самую сложную.
Вы найдете в книге более 50 инструментов улучшения текста. В разделе "Контекст" автор покажет, как справиться с предвзятостью читателей и настроить их на верное восприятие информации. В разделе "Интерес" – как превратить скучный текст в увлекательный, не меняя его содержания. Раздел "Текст" посвящен использованию примеров, антипримеров, аналогий, метафор, сюжетности и слоганов – тому, что поможет адресату правильно понять написанное вами. В разделе "Подача" представлены инструменты мгновенного воздействия: как донести главное заголовком, схемой или фотографией. Максим Ильяхов рассказывает о создании сильного текста, подкрепляя теорию примерами из собственной практики.
Книга адресована всем, кто уже умеет писать и сокращать, но хочет делать это лучше – так, чтобы не только информировать, но и убеждать словом, – копирайтерам, маркетологам, бизнес-тренерам, предпринимателям и блогерам.

83.7
К59
КОЗЕЛКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА Не выходи на люди голым! : конструктор речевого имиджа : практическое руководство / Наталья Козелкова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 133 с. - (Вершина успеха). - 16+. - ISBN 978-5-222-34904-5. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Хотите уметь управлять своими эмоциями и говорить так, чтобы вас слушали и слышали? Этот увлекательный самоучитель по блестящей речи научит! Книга основана на многолетнем опыте практика, диктора Центрального телевидения Гостелерадио СССР Натальи Козелковой, автора уникальной запатентованной методики (основанной на последних открытиях в сферах нейрофизиологии, эндокринологии, соционики и других наук и областей знаний), позволяющей в очень короткие сроки сделать коммуникацию в любой сфере очень эффективной. Читайте, применяйте и наслаждайтесь результатами уже через 21 день!

83
М12
МААСС ДОНАЛЬД Как написать зажигательный роман : инсайдерские советы одного из самых успешных литературных агентов в мире / Дональд Маасс ; пер. с англ. Д. Ключаревой. - Москва : КоЛибри, 2022. - 317, [2] с. - 16+. - ISBN 978-5-389-17924-0. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Какие приемы и техники используют по-настоящему популярные авторы, чтобы постоянно совершенствовать свое письмо и поддерживать убедительность, качество и высокий литературный уровень в каждой следующей книге? Дональд Маасс, президент одного из самых успешных литературных агентств в мире, рассказывает, как создать действительно убедительный, яркий и незабываемый роман - и как делать это снова и снова. Он погружает вас в мир создания и развития сложных персонажей, а также эффектных сюжетных поворотов, ярких сцен и незабываемых диалогов. Книги Дональда Маасса стали культовой классикой среди учебников писательского мастерства и пособий по Creative Writing. Теперь и вы сможете узнать, как написать зажигательный роман и раздуть искры вашей истории в настоящее пламя.

85.377
М741
МОВШОВИЧ ДИН От идеи до злодея : учимся создавать истории вместе с Pixar : [как создать героя, которому будут сопереживать, как удивить зрителя простой идеей, как придумать конфликт и заставить его работать] / Дин Мовшовиц. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2022. - 122, [2] с. - 12+. - ISBN 978-5-04-098043-7. - Текст : непосредственный.
ОИ;
Студия Pixar известна на весь мир своим умением рассказывать истории. Каждый из нас переживал за маленькую девочку, попавшую в настоящую Корпорацию монстров; за юного Молнию Маккуина, мечтающего стать легендой гоночного спорта; за робота ВАЛЛ-И, готового пожертвовать собой ради спасения любимой; и, конечно, за шерифа Вуди и Базза Лайтера, которые уже много лет учат детей умению дружить. Эта книга – сборник секретов повествования работников студии, основанных на вышеупомянутых мультфильмах. Каждая глава раскрывает один из аспектов сторителлинга, которые будут полезны всем, кто хочет рассказывать свои истории. Вы узнаете, как создать живой конфликт и заставить его работать, как добиться того, чтобы твой персонаж не стоял на месте, а развивался и как заставить зрителя дойти с героем до конца. Все эти, а также другие секреты подарят вам вдохновение на создание собственной истории и помогут начать этот путь!

81
С208
САРЫЧЕВА ЛЮДМИЛА Уступите место драме / Людмила Сарычева. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2022. - 268, [2] с. : ил. - (TEXT. UP. Копирайтинг нового уровня). - На обл.: Как писать интересно даже на скучные темы. Копирайтерам, журналистам, редакторам. - 16+. - ISBN 978-5-04-105075-7. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Писательство – не всегда творческий процесс. Об этом не понаслышке знают современные журналисты, редакторы и копирайтеры, которым порой приходится иметь дело с абсолютно скучными текстами, будь то новость, отзыв о клинике или статья о преимуществах лазерных уровней. Такая работа делается быстро и, как правило, предполагает бесконечное копание в таких же монотонных специализированных статьях.
Можно ли сделать подобные тексты интересными для читателя? Людмила Сарычева утверждает: можно и нужно! И предлагает идти на хитрость, применяя драматические приемы там, где это кажется невозможным.
Книга "Уступите место драме" рассказывает, как захватить внимание читателя на разных уровнях: темой, подачей, заголовком, акцентами, композицией, конфликтом. Вы поймете, какие драматические инструменты использовать, чтобы даже самый заскорузлый и формальный текст заиграл новыми красками. Данное издание направлено на тех, кто работает именно с информационными статьями и хочет превратить их в интересные.
Людмила Сарычева обещает: чтобы работать с драматургией, не обязательно быть сценаристом и писателем. Можно уступить немного места драме даже там, где сначала ее не было.

83
У975
УЭЙЛАНД КЭТИ МАРИ Архитектура сюжета : как создать запоминающуюся историю : перевод с английского / Кэти Мари Уэйланд ; переводчик Ольга Корчевская. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2022. - 312, [1] с. - 12+. - ISBN 978-5-00139-326-9. - Текст : непосредственный.
ОИ;
Современная американская писательница Кэти Мари (К.М.) Уэйланд, лауреат престижных литературных премий, не менее популярна как автор учебных пособий по сценарному мастерству и сторителлингу. Книгу "Архитектура сюжета" она посвятила структуре повествования — центральному понятию литературного процесса. Ведь умело выстроенная конструкция не подавляет творческие поиски, а, напротив, облегчает работу писателя и позволяет создавать убедительные сюжеты и объемные характеры.
Подобно архитектору, проектирующему здание, автор крупной литературной формы движется от общего замысла к деталям. Так и в художественном произведении есть макроуровень, состоящий из десяти шагов, которые описывает Уэйланд. Далее автор последовательно останавливается на структуре сцены и предложения.
Книга адресована авторам как художественной прозы, так и сценариев для кино и телевидения, но принесет несомненную пользу всем читателям, причастным к работе над самыми разными текстами.

85.374
Х353
ХЕЙГ МАЙКЛ Голливудский стандарт : как написать сценарий для кино и ТВ, который купят : перевод с английского / Майкл Хейг. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2022. - 494, [1] с. - (Сценарное и писательское мастерство). - 12+. - ISBN 978-5-00139-172-2. - Текст : непосредственный.
ОИ;
Книга Майкла Хейга более 20 лет остается наиболее исчерпывающим руководством для сценаристов кино и телевидения. Настоящее, полностью обновленное издание, отражает последние тенденции в искусстве и бизнесе кино. Гуру кинематографа подробно описывает каждый шаг от идеи до продажи сценария. Исходя из того, что главное – это безупречность самого сценария, Хейг учит добиваться совершенства текста, ни на секунду не упуская из виду всех слагаемых коммерческого успеха. Зная о кино все, автор дает психологически точные советы, как подступиться к нужным людям и добиться их интереса, снабжает читателя исчерпывающими рекомендациями об организационных структурах и источниках информации, делает разбор отдельных сцен множества успешных кинолент, дает полный анализ сценария фильма "Аватар". И все это Хейг пишет так убедительно, что даже человеку, не помышлявшему прежде о карьере в кино, хочется взяться за написание сценария.

85.374
Х991
ХЭЙ ЛЮСИ В. Сценарий триллера : как придумать, как написать, как продать / Люси В. Хэй ; перевод с английского А. Канеевой. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2022. - 304 с. - (Сценарная мастерская. Секреты идеального текста). - 16+. - ISBN 978-5-04-163592-3. - Текст : непосредственный.
ОИ;
Эта книга настоящая последовательная инструкция к созданию успешного сценария фильма в жанре триллер. После основной теории, автор переходит к практическим советам и подробно объясняет на примере популярных триллеров, в чем секрет успеха хорошего сценария.
Какие есть виды триллеров?
Что должен делать главный герой?
Что такое крючок и как им пользоваться?
Для чего нужен поэпизодник?
Как должна выглядеть сценарная заявка?
И, что особенно важно, как и кому продать готовый сценарий?
Но не стоит думать, что речь пойдет только о триллерах. На самом деле книга будет полезна всем, кто занимается сценарным мастерством. Потому что она подробно исследует вопрос "Что делает хороший сценарий хорошим?"
Воскресенье, 11 Июнь 2023 18:17
Книжные новинки. Лето, 2023. Страноведение

26.89(2-2Мос)я2
Ж446
ЖЕБРАК МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ Пешком по Москве с Михаилом Жебраком : эпохи, творцы, жильцы. - Москва : АСТ, ОГИЗ, 2023. - 255 с. : ил. - (Большой путеводитель по городам и времени) (Своими глазами). - 12+. - ISBN 978-5-17-109579-6. - Текст : непосредственный.
ОИ;
Эта книга своеобразный прекрасно иллюстрированный авторский путеводитель по столице России. Книга будет интересна и полезна жителям и гостям мегаполиса, тем, кто любит путешествовать виртуально, погружаясь в познавательный рассказ и выразительные фотографии.
Предлагаем вам пройтись по прекрасным улицам Москвы. Познакомиться с заповедными и знакомыми уголками столицы, где каждое здание — свидетель ярких судеб и поворотных событий. Книга разделена на три части — "Эпохи", "Творцы", "Жильцы". Сначала вспомним самые яркие периоды в истории Москвы, оставившие след в архитектуре и градоустройстве, затем поговорим об архитекторах, а в финальном разделе узнаем заказчиков шедевров архитектуры.

26.89(2)я2
Ж446
ЖЕБРАК МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ Подмосковье с Михаилом Жебраком : самые интересные места. - Москва : АСТ, ОГИЗ, 2021. - 255 с. : ил. - (Большой путеводитель по городам и времени) (Своими глазами). - 12+. - ISBN 978-5-17-121247-6. - Текст : непосредственный.
ОИ;
Автор книги, Михаил Жебрак, – экскурсовод, автор и ведущий программы "Пешком" на телеканале "Культура". Предлагаем вам вместе с Михаилом прогуляться по самым интересным местам Подмосковья.
Для удобства книга разделена на разделы, каждый из которых посвящен основным шоссе, ведущим в Москву. Вы прочитаете о достопримечательностях и о самих дорогах, ведь без истории трассы часто не до конца понятна история конкретного места. Автор выбрал для описания самые яркие и необычные места, то, ради чего стоит свернуть с проторенной дорожки на дачу.
В этом издании вы обязательно узнаете много нового о Подмосковье. Найдете объект, который давно собирались посетить или прочитаете любопытную историю о знакомом городе. Надеемся, эта книга побудит вас совершить путешествие по удивительным местам Подмосковья.

63.3(4Ита-4Вен)
К614
КОЛОСОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА Bella Венеция! : история о жизни города на воде, людях, случаях, встречах и местных традициях / Екатерина Колосова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2022. - 300, [1] с. : ил. - (Великие города). - 16+. - ISBN 978-5-04-120283-5. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Венеция – это намного больше, чем каналы и острова. Это красота и эстетика в каждом здании, улочки, которые, как шкатулка, хранят свои непередаваемые истории. Это невероятное переплетение людей и судеб. Автор в течение многих лет пыталась понять феномен венецианской культуры. Она общалась с разными людьми, в жизни которых Венеция занимает особое место. Кто-то из них здесь живет и занимается любимым делом, кто-то переехал по зову сердца, а кто-то нежно любит город издалека. Богема, ремесленники, аристократы, знаменитости – все это ждет вас на страницах книги о самом необычном городе Италии.

26.89(2-2СПб)я2
Н433
НЕЖИНСКИЙ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Санкт-Петербург : лучшие маршруты по городу и окрестностям / Юрий Нежинский. - Москва : АСТ, ОГИЗ, 2022. - 207 с. : ил. - (Большой путеводитель по городам и времени) (Своими глазами). - 12+. - ISBN 978-5-17-149272-4. - Текст : непосредственный.
ОИ;
Эта книга своеобразный прекрасно иллюстрированный авторский путеводитель по культурной столице России.
Величественный Санкт-Петербург поражает путешественников памятниками архитектуры и искусства, обилием водных пространств и неповторимой атмосферой, роскошными дворцами и императорскими резиденциями. Загляните в тихие улочки, поднимитесь на смотровые площадки, узнайте историю жителей города, и Санкт-Петербург откроет вам свои секреты и поделится потаенными мыслями.
Книга будет интересна и полезна жителям и гостям Санкт-Петербурга, тем, кто любит путешествовать виртуально, погружаясь в познавательный рассказ и выразительные фотографии.
Воскресенье, 11 Июнь 2023 18:15
Книжные новинки. Лето, 2023. Спорт

75.82
К776
КРАКАУЭР ДЖОН В разреженном воздухе : самая страшная трагедия в истории Эвереста / Джон Кракауэр ; пер. с англ. А. В. Андреева. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2023. - 414 с. : ил. - (Проект TRUESTORY. Книги, которые вдохновляют). - 16+. - ISBN 978-5-04-174050-4. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
19 альпинистов-любителей отправляются в Непал, чтобы покорить Эверест.
Это приключение стоит 65 000 долларов. Каждого клиента ведет опытный гид по четко спланированному маршруту. Исход малейшей ошибки известен всем, но желание попасть на вершину затмевает разум.
Однако… Последнее слово остается за горой. Там, на высоте 8848 метров, в разреженном воздухе, мозг потеряет миллионы клеток, тело предательски ослабеет и даже самые опытные начнут совершать одну роковую ошибку за другой. Кто-то выживет, но навсегда останется с чувством вины, а кто-то расплатится за мечту и амбиции собственной жизнью.
Это восхождение не забудет никто.
Самая страшная трагедия в истории Эвереста. От первого лица.

75.579
С899
Суперсерия 72 : история противостояния / Владислав Третьяк, Александр Якушев, Борис Михайлов, Фил Эспозито, Кен Драйден. - Москва : АСТ, Время, 2022. - 286, [1] с. - (Звезды спорта). - На обл.: СССР - Канада. - 12+. - ISBN 978-5-17-151974-2. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Суперсерия 1972 года – одно из величайших событий в истории мирового хоккея. Первая встреча североамериканских профессионалов и советских любителей стала чем-то гораздо большим, чем просто серия статусных международных матчей. Ее можно назвать настоящей ледовой битвой, сражением двух могущественных сверхдержав, ярчайшим противостоянием характеров, менталитетов и устоявшихся стереотипов. Это было соперничество капитализма и социализма, перенесенное в спортивную плоскость. Суперсерия 1972 года не просто открыла для советских людей окно в Северную Америку, но и показала всему миру, что Советский Союз – это не только танки и ракеты. После этой серии из восьми матчей границы, разделявшие хоккеистов-профессионалов и хоккеистов-любителей, были стерты. Звезды хоккея, такие как знаменитый вратарь Владислав Третьяк, бомбардиры сборной Александр Якушев и Борис Михайлов, а также их канадские соперники – Фил Эспозито и Кен Драйден вспоминают самые острые и захватывающие моменты их эпохального противостояния.
Воскресенье, 11 Июнь 2023 18:14
Книжные новинки. Лето, 2023. Религия

86.7
Д631
ДОКИНЗ РИЧАРД Перерастая бога : пособие для начинающих / Ричард Докинз ; пер. с англ. Антона Гопко. - Москва : Corpus, 2022. - 250, [1] с. - (Библиотека фонда "Династия"). - Книжные проекты Дмитрия Зимина. - 12+. - ISBN 978-5-17-119336-2. - Текст : непосредственный.
"Перерастая бога. Пособие для начинающих" - это, с одной стороны, сборник главных аргументов, которыми может вооружиться атеист в споре с верующими, а с другой - масштабный экскурс в историю религий и верований с подробным анализом того, почему возникли эти верования, каких богов они представляли, зачем надо было им поклоняться и почему, в конце концов, эти боги были забыты. Или почему они будут забыты - если речь идет о современных религиях.

86.372
М91
МУРАВЬЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Старообрядцы. Другие православные / Алексей Муравьев. - Москва : Эксмо, 2021. - 143 с. - (Религия. Старообрядчество). - 16+. - ISBN 978-5-04-110580-8. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Эта книга возникла как продолжение разговоров с самыми разными людьми о старообрядцах, о Церкви, об истории и о судьбе России. Cтарообрядцы своим существованием напоминают: раскол не исцелен, ответы на главные вопросы не даны, успокаиваться нельзя, надо иметь смелость пойти до конца. Кажется, только так можно смотреть в будущее нашей страны и нашего народа. Автор рисует общую картину истории и культурной жизни старообрядцев, объясняет принципы их веры и разбирает основные мифы о старообрядцах, укоренившиеся в массовом сознании.

86.372
Т484
ТКАЧЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ Ступени к Небу : как научиться любить людей / протоиерей Андрей Ткачев. - Москва : Эксмо, 2022. - 189, [1] с. - (Книги протоиерея Андрея Ткачева). - 12+. - ISBN 978-5-699-81355-1. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Новая книга протоиерея Андрея Ткачева - о том, как найти себя, и через переживание глубины и величия человечности как Божьего дара научиться строить подлинные отношения с ближними. Во все более ускоряющемся темпе жизни, в растущем вале неотложных дел, среди суеты и шума, так легко потерять себя, надежду и веру. Когда нам кажется, что все у нас уже есть, и пора остановиться на достигнутом, то мы незаметно для себя отдаем все больше пространства наших душ разочарованию во всем: в мире, в людях, в жизни, мы начинаем терять свою глубину. Человеку же нужно постоянно расти, преодолевать некие ступени во всех сферах своей жизни, подниматься вверх, чтобы узнавать себя с совершенно неожиданных сторон. Узнав себя, постигнув свою глубину, мы начнем замечать Христа и ближнего. И тогда любое дело, которое мы будем делать, станет для нас ступенькой к Небу.
Воскресенье, 11 Июнь 2023 18:13
Книжные новинки. Лето, 2023. Психология

88.576
А471
АЛЕКСЕЕВА АННА Я все смогу сама! : как маме одной справиться с трудностями, найти поддержку и устроить новую жизнь / Анна Алексеева. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2022. - 268 с. - (Почти на нуле. Книги, которые помогут уставшим родителям). - 16+. - ISBN 978-5-04-155246-6. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Для многих мам воспитание детей в одиночку становится настоящим испытанием. К финансовым и бытовым сложностям часто добавляются душевная боль после развода, предвзятое отношение окружающих, непонимание, как объяснить ситуацию ребенку. Автор этой книги на собственном опыте пережила то, о чем рассказывает. Ее история утешит в трудный период и покажет, что вы - не одна! Есть множество способов получить помощь и поддержку, выбраться из депрессии и двигаться дальше. Советы автора помогут справиться с проблемами, принять перемены и начать новую счастливую жизнь.
Эта книга подскажет, как:
- совмещать работу с материнством;
- заботиться о детях, не забывая о себе;
- привести в порядок финансы;
- получить материальную, юридическую и психологическую помощь;
- научиться снова получать удовольствие от жизни.

88.576
Б288
БАТЫРЕВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ 45 татуировок родителя : мои правила воспитания / Максим Батырев (Комбат). - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. - 317, [2] с. - (Правила Комбата). - 16+. - ISBN 978-5-00195-809-3. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Долгожданная новинка о родительских татуировках Максима Батырева - автора супербестселлеров, популярного спикера и отца четверых детей.
По признанию самого Максима, для него это самая сложная из написанных им книг. В ней он делится той частью жизни, которую предприниматели обычно не показывают. "Татуировки родителя - это мой опыт, моя рефлексия, мои боль и откровения", - пишет Максим. Он подчеркивает, что ни в коем случае не претендует на роль истины в последней инстанции. Тем не менее 45 принципов воспитания, которых он придерживается и о которых расскажет на страницах книги, точно помогут сделать родительский труд чуть легче, а отношения с детьми лучше и гармоничнее.
Эта книга для мам и пап, которые хотят быть хорошими родителями. Для всех, кто хочет сделать семью и детей счастливее.

88
Б37
БЕГАК АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ Психология : о самой загадочной области - ведущие эксперты страны / Алексей Бегак. - Москва : АСТ, ОГИЗ, 2021. - 236, [3] с. - (Правила жизни). - Светлана Бронникова, Елена Новоселова. - 12+. - ISBN 978-5-17-119741-4. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Правила жизни - серия книг, созданная по одноименным телепрограммам ТРК "Культура". Её постоянный ведущий Алексей Бегак приглашает в собеседники экспертов из разных областей знаний.
Знает ли человек себя? По каким законам живет наш организм? Надо ли уметь бездельничать? Что делать с неуверенностью в себе, можно ли все решать самому, как построить счастливую семейную жизнь, надо ли быть удобным для всех вокруг, как достичь успеха и научиться радоваться жизни. Эти и многие другие темы затронут психологи Елена Новоселова и Светлана Бронникова.

88.576
Б906
БУК ЛЕНА. 50 "можно", с которыми маме станет легче жить / Лена Бук. - Москва : АСТ, Времена, 2023. - 252, [3] с. - (Лидер Рунета). - 16 . - ISBN 978-5-17-154125-5. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Честные ироничные истории этой книги поддержат мам, которые растерялись в декрете, устали от недосыпа и никак не могут найти время на себя. Уникальная авторская система упражнений и практических заданий поможет снизить уровень тревожности и избавиться от чувства вины. Рекомендуется всем, кто хочет выдохнуть и получить от родительства то самое, о котором так много говорят и которого так не хватает в первое время.

74.90
Б953
БЫКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА Малыши "ленивой мамы" в детском саду / Анна Быкова. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2022. - 266 с. : ил. - (Ленивая мама). - 16+. - ISBN 978-5-04-118802-3. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Анна Быкова — популярный российский педагог и психолог, мама двоих сыновей, автор серии бестселлеров "Ленивая мама", опубликованных в 18 странах.
Новое дополненное издание этой книги призвано помочь всем родителям, кто впервые отправляет ребенка в детский сад или уже столкнулся с трудностями при адаптации.
Вы узнаете:
• как маме и малышу комфортно пережить расставание;
• как справляться с истериками, капризами и агрессией;
• как помочь ребенку подружиться с воспитательницей и другими детьми;
• как понять, хорошо ли малышу в детском саду;
• в чем причина плохого аппетита и частых простуд.
Практический опыт автора, профессиональные рекомендации и реальные истории помогут правильно подготовить и себя, и ребенка к новому этапу жизни. А главное, вы поймете, что детский сад — это совсем не страшно!

88.21
В12
ВААЛЬ ФРАНС ДЕ. Последнее объятие Мамы : чему нас учат эмоции животных : перевод с английского / Франс де Вааль ; переводчик Мария Десятова ; с фотографиями и рисунками автора. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. - 441 с. : ил. - (Книжные проекты Дмитрия Зимина) (Библиотека "Династия"). - Библиогр.: с. 416-428. - 16+. - ISBN 978-5-00139-186-9. - Текст : непосредственный.
Испытывают ли животные гордость, стыд, вину или отвращение, как и мы, люди? Есть ли у них чувство справедливости и благодарности? Могут ли собаки смеяться и скорбеть, способны ли слоны утешать друг друга, а обезьяны завидовать, плести интриги и выстраивать планы мести? Чувствуют ли боль рыбы и умеют ли любить птицы? Что общего в поведении альфа-самцов шимпанзе и современных политиков?
В этой доброй и умной книге, помимо трогательной истории шимпанзе по имени Мама, известный приматолог Франс де Вааль рассказывает о своих многочисленных наблюдениях и экспериментах, посвященных изучению эмоций самых разных животных. Наряду с гневом и ненавистью, приводящими даже к преднамеренному убийству себе подобных, животные обнаруживают удивительную способность к состраданию, примирению и прощению. Они, как и мы, способны к эмпатии, взаимопомощи и тесному социальному взаимодействию. Автор рассматривает чувства человека в эволюционном контексте как прямое продолжение эмоций животных и призывает нас осознать нашу неразрывную связь со всеми существами на планете и в конечном счете лучше понять самих себя.

88.53
З-381
ЗАХАРИАДИС ДЕЙМОН Хватит быть удобным : как научиться говорить "нет" без угрызений совести / Деймон Захариадис ; пер. с англ. А. Монич. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2023. - 203 с. - (Бог общения. Говори так, чтобы тебя услышал весь мир). - 16+. - ISBN 978-5-04-121633-7. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Отказ не делает вас плохим человеком. Наоборот, умение говорить "нет" - один из важнейших навыков, которым мы можем овладеть. Он повышает нашу эффективность, улучшает отношения с окружающими и наделяет спокойной уверенностью. И если вам надоело быть удобным и безотказным, - эта книга для вас!
Деймон Захариадес, автор по саморазвитию, предлагает пошаговое руководство по установлению границ и развитию уверенности, необходимой для их поддержания. Овладев искусством говорить твердое вежливое "нет" и регулярно практикуясь в этом, вы заметите, что вас начнут воспринимать иначе. Люди будут больше ценить вас и ваше время и увидят в вас лидера, а не ведомого.
Благодаря этой книге вы:
- избавитесь от привычки угождать людям
- изучите 10 простых стратегий изящного отказа
- узнаете, как устанавливать личные и профессиональные границы
- научитесь давать отпор назойливым окружающим, которые пользуются вашей добротой
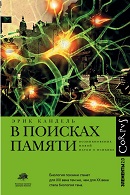
88.25
К192
КАНДЕЛЬ ЭРИК В поисках памяти : возникновение новой науки о человеческой психике / Эрик Кандель ; перевод с английского Петра Петрова. - Москва : АСТ, Corpus, 2021. - 733 с. : ил. - (Библиотека фонда "Династия") (Элементы 2.0). - Книжные проекты Дмитрия Зимина. - 12+. - ISBN 978-5-17-137356-6. - Текст : непосредственный.
Автор разъясняет революционные достижения современной биологии и проливает свет на то, как бихевиоризм, когнитивная психология и молекулярная биология породили новую науку. Книга начинается с воспоминаний о детстве в оккупированной нацистами Вене и описывает научную карьеру Канделя: от его раннего увлечения историей и психоанализом до новаторских работ в области изучения клеточных и молекулярных механизмов памяти, за которые он удостоился Нобелевской премии

88.41
К265
КАРПОВ НИКИТА ЛЕОНИДОВИЧ Чертовы подростки! : как найти общий язык с повзрослевшим ребенком / Никита Карпов. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2023. - 253 с. - Библиогр.: с. 253. - 16+. - ISBN 978-5-04-171557-1. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Детский и подростковый психолог Никита Карпов знает о взрослении все. Более 15 лет он помогает подросткам и родителям найти общий язык и решает их проблемы. В легкой форме, с долей юмора, Никита Карпов рассказывает о реальных кейсах, профессиональных техниках и методиках, которые спасут ваши нервы, наладят крепкие доверительные отношения и помогут воспитать самостоятельного человека. Он раскроет глаза, что на самом деле пубертат - очень интересный период, от которого можно получать удовольствие и родителям, и подросткам.
Из этой книги вы узнаете:
- кто такие эти подростки и что на самом деле их беспокоит;
- как сохранить свои нервы и не срываться на ребенка;
- что советуют делать профессионалы, чтобы построить позитивные отношения и увидеть результат;
- что нужно сделать, чтобы ребенок полностью доверял вам;
- как научиться доверять подростку и отпускать ситуации, которые не требуют контроля.

88.3
К363
КЕРРЕ НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА Вернуть вкус к жизни : что делать, когда все хорошо, но счастья и радости мало / Наталья Керре. - Москва : Альпина Паблишер, 2022. - 253, [1] с. - Библиогр.: с. 253-254. - 16+. - ISBN 978-5-9614-3840-6. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Эта книга не о том, как заработать миллион, моментально достичь процветания в бизнесе и очаровать всех людей на пару километров вокруг. Она о том, как понять, чего вы хотите на самом деле, и разрешить себе стремиться к цели, пусть даже другие крутят пальцем у виска. Ее автор, психолог-консультант Наталья Керре, поможет вам понять и полюбить самих себя – настоящих, без навязанных обществом масок. Она пишет о том, что останавливаться не обязательно в любом возрасте, а делать всегда по-своему – добродетель, ведущая напрямик к счастью. Если вы хотите выбраться из состояния «всё хорошо, но ничего хорошего» и сделать свою жизнь такой, какую раньше не могли даже вообразить, скорее переворачивайте страницу и читайте.

88.576
К566
КОВИ СТИВЕН Р. Счастливый союз : семь навыков высокоэффективных пар : перевод с английского / Стивен Р. Кови, Сандра Кови, Джон Кови, Джейн Кови ; переводчик Матвей Окунев. - Москва : Альпина Паблишер, 2023. - 150, [1] с. - 12+. - ISBN 978-5-9614-4197-0. - Текст : непосредственный.
Все семьи хотят жить в мире и согласии, чтобы поддержка, доверие и взаимное уважение не ослабевали с годами. Но как пройти через жизненные испытания, не утратив желания быть вместе? Помогут семь навыков высокоэффективных пар, выработанные Стивеном Р. Кови — автором бестселлера "Семь навыков высокоэффективных людей". В своей книге доктор Кови и его жена Сандра вместе со своим братом Джоном и его женой Джейн подробно рассказывают об этих методах и о том, как с помощью эмпатии, синергии и стремления к совместному выигрышу построить и укрепить семейный союз.

84(2Рос=Рус)6-4
К614
КОЛОТОВА ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА Холодное детство : как начать жить, если ты нелюбимый ребенок / Яна Колотова. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2022. - 221, [2] с. - (Записки российских блогеров). - 16+. - ISBN 978-5-04-159915-7. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Не думайте, что детство у всех разное и здесь вам ничего не отзовется, наоборот, мы имеем очень много пресечений между собой. Детские травмы случаются в тот период, когда человек незрел и зависим от родителей. Его психика вытесняет невыносимые чувства, с которыми он не может справиться. Год за годом эти "залежи" нарастают и уплотняются, а на поверхности, то есть в поведении появляются: страхи, неврозы, расстройства пищевого поведения (РПП), страсть к чистоте и болезненному поддержанию порядка, депрессия. Яна Колотова, автор блога о материнской нелюбви, предлагает ознакомиться с ее личной историей, которая поможет вам осознать проблему и составить собственный план терапии.

88.576
К78
КРАСАВЧИКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Мама у турникета : счастье материнства на пределе возможностей / Анастасия Красавчикова. - Москва : АСТ, 2022. - 285, [1] с. - (Женская тема). - 16+. - ISBN 978-5-17-152501-9. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Настя Красавчикова - мама двух замечательных лучезарных детишек - Тёмы и Алисы, которые еще до своего рождения стали нескончаемым источником оригинальных литературных идей для их мамы. И даже вдохновили Настю на написание книги "Мама у турникета. Счастье материнства на пределе возможностей".
Книга будет интересна абсолютно каждому, кто хочет провести свой вечер в компании уютной и полезной книжки-компаньона. Она будет особенно интересна состоявшимся и будущим мамам, которые узнают секреты о том, как сохранить свое физическое и психологическое здоровье до и после родов, как принимать себя и мириться с самим собой в сложные периоды беременности и воспитания детей, а главное - о том, как несмотря ни на что любить и ценить каждую секунду жизни рядом с ребенком. И даже с двумя.

88.71
К886
КУГЕЛЬШТАДТ АЛЕКСАНДР Это все психосоматика! : как симптомы попадают из головы в тело и что делать, чтобы вылечиться / Александр Кугельштадт ; [перевод с немецкого Т. Б. Юриновой]. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2022. - 348, [1] с. - (Тело помнит все. Книги о лечении психосоматических болезней и психотравм). - Библиогр.: с. 335-346. - 18+. - ISBN 978-5-04-159527-2. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
"Что ж, тогда это психосоматика", - пожимает плечами доктор, а ваш мир рушится, ведь только что этими самыми словами вам сказали: "Мы ничем не можем вам помочь". Так кто же помочь может, если даже врачи не могут найти причину ваших проблем со здоровьем? Вы сами!
Эта книга, написанная доктором медицины, врачом-психосоматологом Александром Кугельштадтом, не просто объяснит, что с вами происходит, но и даст план по выздоровлению без сильнодействующих лекарств. Автор проведет своеобразную экскурсию по человеческому телу, от головы до пят, и расскажет о связи беспокоящих физических симптомов, например выпадения волос или боли в животе, и психики.
- Почему вы иногда неосознанно принимаете решения, не понимая их причин?
- Как взаимодействие с родителями в младенчестве влияет на развитие мозговых структур?
- Почему важно не только регистрировать телесную реакцию, но и расшифровывать охватившее чувство?
Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете внутри.

88.56
К983
КЭМП ДЖИМ Нет : (лучшая стратегия ведения переговоров) : уникальная система подготовки, планирования и ведения переговоров, с помощью которой ежегодно заключаются сделки на общую сумму более 100 миллиардов долларов / Джим Кэмп. - Москва : Добрая книга, 2021. - 294, [1] с. - 16+. - ISBN 978-5-98124-324-0. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Если всякий раз, когда ваш партнер по бизнесу, угрожая разрывом отношений, вынуждает вас предоставлять ему скидку, а вы боитесь потерять клиента и думаете о том, как умиротворить его, то у Джима Кэмпа есть для вас другой, более эффективный способ ведения переговоров: просто скажите "нет".
"Нет" - самый эффективный инструмент в арсенале переговорных методик, позволяющий пресечь бесплодные дискуссии и отбросить ложные предположения и ненужные компромиссы. Прочитав эту книгу, вы освоите уникальную систему подготовки, планирования и ведения переговоров. Вы узнаете:
- как перестать зависеть от результата переговоров, который вы не можете контролировать, и сконцентрироваться на том, чем вы можете управлять, - на собственном поведении;
- что и как следует говорить за столом переговоров: как "вести" противника с помощью правильно поставленных вопросов;
- как управлять переговорным процессом и эффективно реагировать на все, что бы ни происходило за столом переговоров;
- как противостоять сильному противнику, использующему давление и манипуляцию.

88.576
Л566
ЛИ КОРИ ЖАСМИН Мамина нелюбовь : как исцелить скрытые раны от несчастливого детства / Жасмин Ли Кори ; перевод С. Богданова. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2022. - 395, [4] с. - (Травма и исцеление. Истории психотерапевтов). - Библиогр.: с. 391-396. - 16+. - ISBN 978-5-04-118086-7. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
В жизни не так много переживаний, настолько же глубоких, как чувства, которые мы испытываем к нашим матерям. Корни некоторых этих чувств теряются в темных тайниках доречевого опыта. Ветви расходятся во все стороны, одни несут дивные, пропитанные солнцем моменты, а другие обломаны, с острыми и занозистыми краями, за которые мы постоянно цепляемся. Мать - не простая тема. Мы защищаем образ матери внутри себя, защищаем наши хрупкие с ней отношения путем отрицания всего, что могло бы его расшатать, и защищаем себя от разочарования, злости и боли, которые вытесняем из сознания. В своей книге психотерапевт Жасмин Ли Кори рассказывает, как исцелиться от детских психологических травм и стать уверенным в своих силах любящим взрослым.

88.3
Л641
ЛИТВАК БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 7 шагов к стабильной самооценке / Борис Литвак. - Москва : АСТ, Времена, 2022. - 351 с. - 16+. - ISBN 978-5-17-108536-0. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Приходя на тренинги или обращаясь к книгам по психологии, люди очень редко формулируют свою проблему с упоминанием самооценки. Хотя на самом деле именно она является фундаментом, на котором строится личность человека.
Выделяя типы присущей нам самооценки, Борис Литвак предлагает варианты решения проблем и дает задания, выполнение которых поможет вам понять себя и отследить мотивы ваших решений. Все это в дальнейшем даст возможность управлять своей жизнью и находить ответы на сложные вопросы самостоятельно.

88.252
Л654
ЛИХИ РОБЕРТ Лекарство от нервов : как перестать волноваться и получить удовольствие от жизни / Роберт Лихи ; [перевела с английского П. Ярышева]. - Санкт-Петербург : Питер, 2022. - 414, [1] с. - (Сам себе психолог). - 16+. - ISBN 978-5-4461-0574-8. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Волнение захлестывает вас в самые неподходящие моменты? Беспокойство становится вашей второй натурой? Вы много раз перепроверяете себя, и, все равно, не можете успокоиться? На протяжении более двадцати пяти лет доктор Роберт Л. Лихи успешно помог тысячам людей победить волнение и беспокойство. Эта книга, известная во всем мире, содержит программу, включающую практические, простые в использовании советы и методы, и поможет вам:
Выяснить глубинные причины тревоги и способы ее сдерживания.
Отличать продуктивную и непродуктивную тревогу.
Взять под контроль чувство времени и чувство срочности, которые усиливают беспокойство.
Переместить фокус внимания с неудач на возможности.
Остановить тревогу, которая мешает получать удовольствие от жизни.
Вы научитесь спокойно и уверенно решать, как общие жизненные вопросы, так и конкретные задачи, связанные с отношениями, здоровьем, деньгами, работой и необходимостью самоутверждения в мире. Хватит тревожиться, начинайте жить!

88.252
Л654
ЛИХИ РОБЕРТ Свобода от тревоги : справься с тревогой, пока она не расправилась с тобой / Роберт Лихи ; [перевела с английского А. Соломина]. - Санкт-Петербург : Питер, 2022. - 398, [1] с. - (Сам себе психолог). - Библиогр.: с. 385-398. - 16+. - ISBN 978-5-4461-0637-0. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Перед любым ответственным событием вы трясетесь от ужаса?
Не можете уверенно разговаривать с начальником?
Боитесь, что с вашими детьми случится что-то плохое?
Из этой книги вы узнаете, как обмануть свой страх и научиться справляться со стрессом. Здесь вы найдете простое пошаговое руководство, чтобы преодолеть любые виды беспокойства. Теперь вы навсегда избавитесь от тревоги и начнете жить полной жизнью.

88.9
М266
МАРКАТУН МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА Мама, которая не любит : взгляд психотерапевта на сложные отношения матери и дочери / Марна Маркатун. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2023. - 254, [1] с. - (Практическая психотерапия). - Библиогр.: с. 254-255. - 16+. - ISBN 978-5-04-164501-4. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Психотерапевт Марина Маркатун более 36 лет наблюдает в своем кабинете за сложными отношениями между матерью и дочерью. Она убедилась, что недостаточно описать личность и определить тип отношений. Нужно понять, как видит мир мать, а как на те же самые события смотрит дочь. 12 матерей и их взрослые дочери рассказывают историю своей жизни. Каждую сопровождает комментарий специалиста, в котором автор объясняет поведение матерей и дает свои рекомендации для выхода из конфликта. Все истории основаны на реальных случаях из практики.
Из этой книги вы узнаете:
- как дочь копирует поведение своей матери, даже когда у них разные взгляды на жизнь;
- что чувствует взрослый ребенок, которому недоставало маминого внимания в детстве;
- как принимать самостоятельные решения, когда "мама знает лучше";
- через что проходит семья, когда мать страдает от алкогольной или наркотической зависимости;
- как видит мир нарциссическая мать.

88.576
М363
МАХМУТОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА Мамочка, не кричи! : воспитание без крика и маминых истерик / [Надежда Махмутова]. - Москва : Эксмо, 2022. - 251, [1] с. : ил. - Автор указан на обл. - 16+. - ISBN 978-5-04-113530-0. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Из каждого утюга мамы слышат: "Крик травмирует психику ребенка!", "Нормально, что ребенок не слушается", "Уставшая мама – беда для всех". Вроде дельные слова, правильные. Но что с ними делать, как перестать кричать на ребенка, адекватно воспринимать его непослушание и найти время на себя? Что делать, когда накрывает так, что теряешь контроль?
Книга Надежды Махмутовой, практикующего детского психолога и мамы двоих детей, поможет вам определить истинную причину крика и научит работать именно с ней. Вы узнаете, чем заменить крик. Научитесь выражать свои эмоции безопасно для себя и окружающих
Вы найдете ответы на важные вопросы:
- Что происходит с ребенком, когда мама кричит?
- Как вернуть ребенку чувство безопасности?
- Что делать, когда мама устала от детей? Нормально ли это?
- Что такое эмоциональное выгорание и как его проработать?
- Как установки влияют на нашу жизнь и отношения с детьми?
- Что делать, если разрушена эмоциональная связь с ребенком?
- Какие упражнения эффективны для профилактики срывов?
- Что сделать, если все-таки накрывает?

88.8
М83
МОСС ДЖЕН Эпидемия выгорания : как спасти себя и других от хронического стресса, бессонницы и потери мотивации / Джен Мосс ; перевод с английского Ю. Петьковой. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2023. - 286 с. - (Книги-драйверы). - 16+. - ISBN 978-5-04-168250-7. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Эта провокационная книга объясняет, что на самом деле нужно сделать, чтобы потушить других и не сгореть самому и почему забота о себе - далеко не лучшее лекарство от выгорания. Методики, собранные здесь, в отличие от обычных советов "поспать" и "замедлиться", разбираются не с симптомами, а с самим источником проблемы.
Известная журналистка и социальная исследовательница Джен Мосс рассказывает о:
- 6 главных причинах выгорания;
- методах организации работы, которые помогут сохранить ментальное здоровье.
- самых бесполезных (и самых распространенных) способах борьбы с эмоциональным истощением…
- …и о самых действенных.
Эта книга в том числе для руководителей, которых беспокоит, смогут ли их подчиненные завтра подняться с постели. И для всех, кто чувствовал себя усталым, разбитым и демотивированным.

88.3
М894
МУЖИЦКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА Теория невероятности : как мечтать, чтобы сбывалось, как планировать, чтобы достигалось / Татьяна Мужицкая. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2022. - 189, [1] с. - 16+. - ISBN 978-5-04-096135-1. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Книга Татьяны Мужицкой - известного психолога, тренера и телеведущей - раскрывает механизмы исполнения желаний. Она предлагает до изящного простую технологию превращения "хочу" в "имею". Без аффирмаций, визуализаций и танцев с бубном. Зато почти со стопроцентной гарантией, что задуманное сбудется. Главное - быть последовательным и оперативно реагировать на счастливые возможности, которые подкидывает судьба.

88.41
Н624
НИКИТИНА-ФИСУН АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА Травить нельзя остановить : 25 школьных историй о том, как защитить себя и друзей : [с комментариями психолога и юриста] / Настя Никитина-Фисун, Алена Серая ; [иллюстрации Миши Ильвес]. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2022. - 253 с. : ил. - 16+. - ISBN 978-5-04-102137-5. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Школьная жизнь – не только про первую любовь и дружбу на всю жизнь, но и про поиск и принятие себя. Поэтому молодые люди часто сталкиваются с травлей, или буллингом. Причиной может быть как яркий цвет волос или фамилия, так и неполная семья или ограниченные возможности здоровья. Эта книга в форме дневника чуткого и отзывчивого мальчика по имени Вася научит, как постоять за себя в трудной ситуации, почему стоит бороться за мечты и к кому обратиться, если справиться своими силами не получается. Дополненная советами психолога и юриста, она поможет каждому: жертве буллинга, тому, кто наблюдал за травлей со стороны или даже травил других. Авторы, которым не хватило совета и поддержки, когда травили их, теперь протягивают руку помощи вам.

88.42
Н636
НИКОЛЕНКО ЕЛЕНА ИГОРЕВНА К черту хаос : организация взрослой жизни, наполненной смыслом / Лена Николенко. - Санкт-Петербург : Питер, 2022. - 158 с. - (Young Adult Nonfiction). - 16+. - ISBN 978-5-00116-711-2. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Социальные сети, необъятный выбор возможностей, успешный успех, нехватка времени, поиски себя… Что с этим делать?
Борьба за порядок, прежде всего в своей голове, отнимает почти все наши силы. Мы тратим уйму времени, чтобы найти ответы на вопросы, которые вряд ли волновали наших родителей.
Что такое призвание и нужно ли его искать?
Чему учиться в XXI веке?
Как работать с мотивацией и дисциплиной?
Где искать счастье?
Вместе с автором книги Леной Николенко — молодым ученым-когнитивистом, автором блога об эффективном обучении (@lena__nikol) — вы определите, что важно успеть в первые годы взрослой жизни и как научиться жить в мире, который постоянно меняется.
В книгу включены практические советы, ссылки на лекции мировых ученых и список книг, которые учат думать.

88.50
П246
ПЕЛЕХАТЫЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ Яростное НЛП : незаметные техники разрушения личности / Михаил Пелехатый, Евгений Спирица. - Санкт-Петербург : Питер, 2023. - 237, [1] с. - (Бизнес-психология). - 16+. - ISBN 978-5-4461-2311-7. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Мы все находимся под ударом каждый день. Вокруг нас люди, большинство из которых применяют к нам неэтичные меры воздействия, разрушающие нас изнутри. Оказалось, что сделать из нас истеричек и психов, неконтролирующих свои действия и чувства - легче легкого. И тут нет исключений.
Чаще всего это происходит незаметно, с милой улыбкой, со стремлением "причинить добро", с ненавязчивым утверждением своего мнения… Не успеете оглянуться, как ваша жизнь и не ваша вовсе - теперь вы исполняете чужую волю. И ничего не решаете.
Яростное НЛП - это непробиваемая броня, оберегающая вас от любой психологической атаки агрессора. С его помощью вы распознаете на самом начальном этапе любое вмешательство в вашу психику, найдете способы защиты от незаметных деструктивных воздействий и научитесь виртуозно влиять на агрессоров.
Издание адресовано всем, кто хочет лично нести ответственность за свою жизнь, кто не согласен быть ведомым, а хочет вести за собой; кто хочет избавиться от чужого влияния...

88.41
П246
ПЕЛЛАЙ АЛЬБЕРТО Слишком рано : сексвоспитание подростков в эпоху интернета / Альберто Пеллай ; под науч. ред. Анны Левинской ; пер. с итал. В. О. Изюменко. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2022. - 237, [1] с. - (Детям про это. Книги для родителей). - Библиогр.: с. 231-236. - 18+. - ISBN 978-5-04-175271-2. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Детям для здорового сексуального воспитания нужны родители. С каждым годом все больше несовершеннолетних имеют личный смартфон или планшет, а средний возраст, в котором они первый раз самостоятельно используют эти устройства, уменьшается. В этой книге Альберто Пеллай на основе своего опыта психотерапевта и папы (у него четверо детей) предлагает свои методы наиболее "безопасного" прохождения периода взросления и становления вашего ребенка в современном "цифровом" мире. Он затрагивает следующие волнующие темы: социальные сети и "цифровое поколение", СМИ и интернет, мода на сексуальность среди девочек-подростков, зависимость от видеоигр – тревожные звонки, технические способы оградить ребенка от ненужного контента.
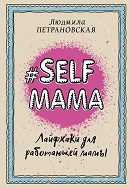
88.576
П30
ПЕТРАНОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА #Selfmаmа. Лайфхаки для работающей мамы / Людмила Петрановская. - Москва : АСТ, 2022. - 220, [3] с. - (Библиотека Петрановской). - 12+. - ISBN 978-5-17-099196-9. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Дети или работа? Молодые и талантливые женщины мучают себя этим вопросом со времени появления джинсов и домашнего интернета. А что, если попробовать не выбирать? Людмила Петрановская умело доказывает: быть хорошей матерью и отличным работником - возможно! Хватит мучиться угрызениями совести и переживать. У работающих мам вырастают замечательные дети!
"Селфмама. Лайфхаки для работающей мамы" - это практические советы для современных мам, которые стремятся уделять равное количество сил и энергии каждой из сторон своей личности. Простые хитрости, описанные в этой книге, позволят вам избежать жертв в гонке за двумя зайцами: карьерой и семьей. Вы поймете, как можно успеть все, не прибегая к услугам Мэри Поппинс, помощи маховиков времени и волшебства.

88.41
П30
ПЕТРАНОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА Врослые и дети. #Много букв / Людмила Петрановская. - Москва : АСТ, 2022. - 314, [4] с. : ил. - (Людмила Петрановская: психология и публицистика). - 12+. - ISBN 978-5-17-144799-1. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
В данной книге собраны тексты разных лет из блога Людмилы. В нем она размышляла о детях и взрослых, отвечала на вопросы родителей, рассказывала о проблеме сиротства и защите прав детей.
Какие возрастные задачи решаются в разные периоды детства, как говорить с детьми о тяжелых вещах, какие слова могут поддержать ребенка, как влияет на нашу жизнь детский опыт, как реагировать на травлю и что в этом случае можно сделать, почему ребенку важно расти в семье и с какими сложностями сталкиваются приемные родители. Эти и многие другие темы звучат в книге очень лично, в жанре разговора с читателем.

88.3
П764
ПРИМАЧЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА К себе нежно : книга о том, как ценить и беречь себя / Ольга Примаченко. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2023. - 328, [5] с. - 16+. - ISBN 978-5-04-117369-2. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
"К себе нежно" - это новый, очень честный взгляд на любовь к себе. Это книга-медитация, которая призывает к внутреннему разговору и помогает услышать собственный голос среди множества других.
Автор книги Ольга Примаченко говорит с читателем о важном: о принятии своих чувств, желаний и тела, о расставлении приоритетов и границ, о создании питательного пространства вокруг себя, а также об экологичном взаимодействии с миром и людьми.

88.3
С249
СВИЯШ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ Невозможное возможно : [7 принципов успешной жизни : доступная технология работы с подсознанием] / Александр Свияш. - Москва : АСТ, 2023. - 250, [3] с. - (Пространство саморазвития). - Библиогр.: с. 252. - 16+. - ISBN 978-5-17-152541-5. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
В этой книге изложена простая и доступная технология внутренних изменений, основанная на работе с Подсознанием человека. На данный момент это самая эффективная методика, модифицированная в соответствии с требованиями времени. Она не требует специальной подготовки, посещения дорогостоящих курсов или семинаров. Она занимает минимум времени и позволяет людям легко и просто достигать поставленных перед собою целей.
Уникальная технология Александра Свияша работает в любой сфере вашей жизни, а не только в бизнесе или карьере.

88.41
С284
СЕДЛИ БЕН Полный отстой! : как победить грусть, тревожность, чувство вины, стресс и вот это все : [для среднего школьного возраста] / Бен Седли ; пер. с англ. Антонины Лаировой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 95 с. : ил. - (Ключ к себе). - 12+. - ISBN 978-5-00195-275-6. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Иногда подросткам все кажется отстойным. Этот иллюстрированный гид поможет справиться с негативными мыслями и сосредоточиться на том, что действительно имеет значение.
Для кого эта книга?
Для подростков, которые часто испытывают негативные эмоции — беспокойство, печаль, одиночество, гнев, стыд и т.п., и это мешает им нормально жить.
Для родителей, которые хотят помочь детям принимать свои эмоции, определять приоритеты в своих чувствах и заботиться о себе.

88.576
С31
СЕНАРИГИ ДЖИНА Любите больше, сражайтесь меньше : навыки общения, необходимые каждой паре / Джина Сенариги ; [перевела с английского И. Малкова]. - Санкт-Петербург : Питер, 2022. - 281, [1] с. - (Сам себе психолог). - 16+. - ISBN 978-5-4461-2913-3. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Вступая в отношения, мы ищем стабильности и безопасности, но вместо этого каждый день воюем из-за мелочей, ссоримся по пустякам, незаметно раним близких. И часто задаемся вопросом: «А что, если мы настолько разные, что не подходим друг другу?»
Большинство из нас не умеют разбираться с конфликтами адекватно, ведь ролевые модели, которые мы усвоили еще в детстве не показывали, как справляться с обидами, недовольством и недопониманием.
Тренер по отношениям доктор Джина Сенариги делится с нами стратегиями для эффективных коммуникаций, восстановления доверия и прощения обид. Автор обучает навыкам работы с отношениями всех статусов – «состою в браке», «встречаемся» и даже «все сложно».
В этой книге вы найдете: 30 коммуникативных навыков и действий, 29 распространенных ловушек в отношениях, пошаговое руководство и экспертное понимание, чтобы меньше сражаться и больше любить.

88.41
С323
СЕРГИЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА Эмоциональный интеллект ребенка и здравый смысл его родителей / Е. Сергиенко, Е. Хлевная, Т. Киселева. - Москва : АСТ, Малыш, 2021. - 255 с. : ил. - (Легкий старт). - ISBN 978-5-17-122021-1. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Все мы хотим, чтобы наши дети заняли достойное место в обществе. Поэтому стараемся дать им лучшее. Часто из самых добрых побуждений мы развиваем только их интеллектуальные способности, начинаем чуть ли не годовалого малыша учить читать и считать. При этом мы руководствуемся правилом: "Эмоциям не место в жизни, главное — знания, умения и навыки". Но так зачастую не удается добиться успеха. Ученые доказали, что для гармоничного развития человеку недостаточно совершенствовать только IQ. Есть еще область чувств и эмоций, про огромный потенциал которой мы обычно даже не догадываемся. В этой книге ведущие отечественные психологи объяснят, что такое эмоциональный интеллект, как он может улучшить качество жизни, раскрыть новые горизонты воспитания и развития ваших детей. Увлекательные упражнения помогут сформировать навык управления своим эмоциональным состоянием.

88.3
Т66
ТРЕЙСИ БРАЙАН Возрождение после кризиса : 12 шагов для перезагрузки карьеры и жизни / Брайан Трейси ; пер. с англ. С. Э. Борича. - Минск : Попурри, 2022. - 235, [2] с. - 16+. - ISBN 978-985-15-5171-8. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Изменив мышление, вы измените свою жизнь
Главная метафора этой книги отсылает нас к древнегреческой легенде о фениксе — птице, которая возрождается из пепла. Ее автор, знаменитый Брайан Трейси, проводит параллели с ситуациями, в которых сегодня оказываются многие из нас: низкая результативность, отсутствие успеха, повседневная рутина.
В условиях пандемии люди и организации ищут пути «возрождения из пепла», которые позволят им найти себя и стать еще сильнее.
Книга научит вас:
* вырабатывать в себе стрессоустойчивость
* находить более быстрые пути достижения целей
* ставить перед собой гибкие задачи, которые легко адаптируются к быстро меняющимся экономическим условиям
* удваивать силу своего ума и обострять интуицию
* избавляться от негативных эмоций
* устранять факторы потери времени, такие как электронная почта, мессенджеры и другие средства электронной связи
* применять надежную формулу из 12 пунктов, позволяющую повысить производительность в 4 раза
* поддерживать и укреплять отношения с самыми значимыми людьми

88.576
У632
УОЛИНН МАРК Это началось не с тебя : как мы наследуем негативные сценарии нашей семьи и как остановить их влияние / Марк Уолинн ; перевод с английского Е. Цветковой. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2023. - 301, [1] с. - (Практическая психотерапия). - 16+. - ISBN 978-5-04-102313-3. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Душевная или физическая боль не возникает сама по себе и не всегда излечивается со временем. Ее корни могут лежать не в нашем жизненном опыте или в химическом дисбалансе мозга - а в жизни наших родителей, бабушек и дедушек и даже прадедушек. Последние научные исследования подтверждают то, что многие уже давно интуитивно понимают - травматический опыт может передаваться из поколения в поколение. В своей книге Марк Уолинн, ведущий специалист по работе с семейной травмой, предлагает техники, которые позволят выявить страхи и тревоги, отражающиеся в повседневных словах, поведении и физических симптомах.

88.41
Ф121
ФАБЕР АДЕЛЬ Как говорить с детьми, чтобы они учились / Адель Фабер, Элейн Мазлиш ; пер. с англ. Т. О. Новиковой. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2022. - 285, [1] с. : ил. - 16+. - ISBN 978-5-04-165451-1. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Самые известные в мире специалисты по общению с детьми, авторы многомиллионного бестселлера "Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили" Адель Фабер и Элейн Мазлиш предлагают уникальную стратегию общения с детьми, с помощью которой можно приучить детей к сосредоточенности, самодисциплине и ответственности, мотивировать их на успех.

88.41
Ф121
ФАБЕР АДЕЛЬ Как говорить, чтобы подростки слушали, и как слушать, чтобы подростки говорили / Адель Фабер, Элейн Мазлиш ; пер. с англ. Д. Куликова. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2022. - 238, [1] с. : ил. - 12+. - ISBN 978-5-04-154828-5. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Адель Фабер и Элейн Мазлиш — самые известные в мире специалисты по общению с детьми, авторы бестселлеров, ставших классикой литературы по воспитанию. Их методика основана на профессиональном и личном опыте: большое количество наглядных примеров и практических советов, понятные диалоги, забавные комиксы. Благодаря Фабер и Мазлиш миллионы родителей научились правильно общаться со своими детьми и легко решать проблемы, возникающие в процессе воспитания.
Эта книга поможет:
• Достичь того, чтобы подросток обсуждал с вами свои проблемы.
• Научить его брать ответственность за свои поступки.
• Говорить о сексе и наркотиках, не отталкивая ребенка нравоучительным тоном.
• Разрешать любые конфликты мирным путем.
• Поддерживать с подростком доверительные отношения.

88.41
Ф551
ФИЛОНЕНКО ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА Свой среди своих : как научить ребенка дружить / Елизавета Филоненко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 142, [1] с. : ил. - (Время для ребенка). - Библиогр.: с. 143. - 0+. - ISBN 978-5-222-37675-1. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Общение с людьми может приносить большую радость. Но как быть, если это общение приносит одни только огорчения? А ещё если дело касается вашего ребёнка? Нет друзей, не принимают в игру, не зовут на дни рождения...
Из этой грустной истории есть выход. С помощью книги, которую вы держите в руках, можно помочь ребёнку понять, что отличает детей, с которыми хотят подружиться, как стать хорошим партнёром по игре, как привлекать и удерживать друзей, как выбирать именно тех, кто тебе подходит.
В игровой форме мы постарались осветить разные стороны детской дружбы, снабдив книгу полезными советами, упражнениями и инструкциями.
Книга будет полезна тем, кто хочет помочь своему ребёнку обрести уверенность в компании детей и повысить его авторитет.

88.1
Ф834
ФРАНКЛ ВИКТОР ЭМИЛЬ Воля к смыслу : перевод с английского / Виктор Франкл ; Переводчик Любовь Сумм. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2022. - 227 с. - 12+. - ISBN 978-5-91671-848-5. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
"Воля к смыслу" - одна из самых авторитетных, блестящих, богатых на афоризмы и точные формулировки работ основоположника логотерапии, психиатра и невролога Виктора Франкла. Этот классический труд не утратил своей актуальности и написан столь доступно, что круг его читателей практически не ограничен. Автор выстраивает иерархию целей и ценностей и исследует многомерный потенциал личности, вмещающей в себя целый мир и ответственной за происходящее в ее судьбе. Говоря об экзистенциальном вакууме, стрессах и кризисах, воле к смыслу и жизни, о психологии и религии, Виктор Франкл дает ответы на вопросы, важные для любого современного читателя.

88.25
Х859
ХОФФМАН ДОНАЛЬД Как нас обманывают органы чувств / Дональд Хоффман ; пер. с англ. М. Максимовой. - Москва : АСТ, Времена, 2022. - 303 с. : ил. - (Понятная медицина). - 16+. - ISBN 978-5-17-150161-7. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Эта книга для тех, кто одержим вопросом о том, как на самом деле утроен человек и мир, в котором он живет.
Можем ли мы безоговорочно доверять нашим чувствам и тому, что мы видим? С тех пор как Homo sapiens появился на земле, естественный отбор отдавал предпочтение искаженному восприятию реальности для поддержания жизни и размножения. Как может быть возможно, что мир, который мы видим, не является объективной реальностью? Мы видим мчащийся автомобиль, но не перебегаем перед ним дорогу; мы видим плесень на хлебе, но не едим его. По мнению автора, все эти впечатления не являются объективной реальностью. Последствия такого восприятия огромны: модельеры шьют более приятные к восприятию силуэты, а в рекламных кампаниях используются определенные цвета, чтобы захватить наше внимание. Только исказив реальность, мы можем легко и безопасно перемещаться по миру.
В путешествии по самым таинственным уголкам человеческого тела и сознания вас ждут жизненные истории и шокирующие факты из области когнитивистики, фундаментальной физики, эволюционной биологии и других революционных областей научного знания.
Почему мы безоговорочно доверяем глазам и остальным органам чувств? Потому что они сообщают нам истину! Истину, необходимую для комфортной и безопасной жизни. А что если подлинная реальность выглядит иначе?

88.41
Х997
ХЮТЕР ГЕРАЛЬД Непослушные дети добиваются успеха : как перестать беспокоиться об оценках и разглядеть в ребенке талант / Геральд Хютер, Ули Хаузер ; перевод с английского Е. В. Голандской. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2021. - 190, [1] с. - (Baby Boom! Лучшие книги для родителей). - 16+. - ISBN 978-5-04-116072-2. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Рассмотреть талант трудно. Особенно сложно, когда речь идет об открытии одаренности в юном возрасте.
Вам кажется, что ваш ребенок тот еще хулиган? А что, если это его особый способ познавать мир?
Что бы случилось, если бы родители Эйнштейна спугнули мечты сына и запретили ему днями напролет строить лишь карточные домики? Что, если бы учителя не позволили ему часами искать ответ на один вопрос, не относящийся к школьной программе?
Из книги вы узнаете:
- Как перестать создавать давление и стресс даже в общении с самыми маленькими детьми.
- Как помочь ребенку максимально реализовать свой потенциал, заложенный при рождении.
- Чего делать не стоит, чтобы не перекрыть природную тягу к познанию.

88.41
Ш611
ШИМАНСКАЯ ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Мама, я боюсь! : как научить ребенка справляться со страхом / Виктория Шиманская, Александра Чканикова. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 190 с. : ил. - (Воспитание без стесса). - 16+. - ISBN 978-5-00195-661-7. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Как отличить страх от тревоги? Что делать, если ребенок боится общаться со сверстниками? Как говорить о войне, смерти и других пугающих вещах? Книга поможет заботливым взрослым найти подход к детским страхам, экологично успокоить напуганного ребенка и научить его извлекать пользу из древней и естественной эмоции.
Познавая мир, ребенок может найти в нем много страшного: от злой собаки до чудовища под кроватью. Порой его охватывает тревога перед контрольной или пугает возможная потеря близких. Взрослым - родителям, учителям, бабушкам или дедушкам - бывает трудно обсудить эти страхи с детьми, не обесценивая и не пристыжая, ведь мы сами легко поддаемся панике.
Авторы книги, эксперты в области эмоционального интеллекта, предлагают не избавляться от страхов и не отрицать их, а находить в них пользу и ресурс - так, чтобы страх становился для ребенка не врагом, а союзником.
К каждой главе книги прилагаются практические задания и упражнения для детей и родителей, а также примеры диалогов с ребенком в каждой конкретной ситуации. Благодаря этому вся семья сможет шаг за шагом подружиться со страхами.
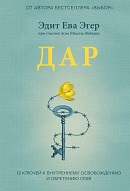
88.9
Э172
ЭГЕР ЭДИТ ЕВА Дар : 12 ключей к внутреннему освобождению и обретению себя / Эдит Ева Эгер при участии Эсме Швалль-Вейганд ; перевод с английского Татьяны Лукониной. - 2-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 253, [2] с. - (Больше чем жизнь). - 16+. - ISBN 978-5-00195-092-9. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
В новой книге Эдит Эгер развивает свою мысль об исцелении и подсказывает путь, который мягко и бережно помогает изменить мысли и убеждения, удерживающие нас в плену прошлого. Доктор Эгер объясняет, что самой страшной тюрьмой, в которой она оказалась, была не та, куда ее отправили нацисты, а та, которую она создала сама для себя, тюрьма ее собственного разума. Автор описывает 12 самых распространенных известных ей установок, лишающих нас свободы, в том числе синдром жертвы, избегание, игнорирование себя, стыд, осуждение, непрощение, страх, отчаяние, а также предлагает инструменты для их устранения. Каждая глава сопровождается историями из собственной жизни доктора Эгер или из жизни ее пациентов и включает наводящие на размышления вопросы и выводы.
Книга поможет:
Обрести силу духа тогда, когда кажется, что надежды уже нет.
Отпустить свои самоограничивающие убеждения.
Справиться с горем и чувством стыда.
Увидеть, как гнев запирает нас в плену и как можно из него освободиться.
"Дар" - книга, полная сочувствия, понимания и поддержки, в ней отражена наша уязвимость и общие проблемы, с которыми все мы сталкиваемся. Практическое руководство от автора о том, как менять мысли, поведение, как избавляться от мрачных призраков прошлого, которые не дают двигаться вперед.

88.3
Э499
ЭЛРОД ХЭЛ Магия утра : как первый час дня определяет ваш успех / Хэл Элрод ; перевод с английского Оксаны Медведь. - 10-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 234, [1] с. - (Чудесное утро - чудесная жизнь). - 12+. - ISBN 978-5-00195-131-5. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Некоторые книги меняют наше отношение к жизни. И лишь редкие из них меняют наш образ жизни и поведение. Книга Хэла Элрода делает и то, и другое – и быстрее, чем вы можете себе представить. Из нее вы узнаете, как первый час после пробуждения определяет успех всего дня и помогает раскрыть свой потенциал. Следуя советам автора, десятки тысяч человек улучшили свое здоровье, стали больше зарабатывать, научились фокусироваться на ключевых задачах и, главное, стали счастливее. Эта книга для всех, кто хочет изменить жизнь, начав с малого – с первого утреннего часа.
Воскресенье, 11 Июнь 2023 18:11
Книжные новинки. Лето, 2023. Педагогика. Особенные дети

74.3
Б879
БРИКУНОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. Сенсорно-творческое развитие детей с РАС: проблемы, методика, диагностика / Светлана Брикунова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 131, [1] с. : ил. - (Особенные дети). - Библиогр.: с. 129-131. - 0+. - ISBN 978-5-222-37590-7. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Сегодня результаты творчества детей с особенностями развития широко известны в мире, их работы действительно интересны и актуальны. В процессе освоения ребенком новых для него способов действия происходит становление качественно новой для него творческой активности, что может выступить в качестве и фактора, и критерия функционального развития, созревания личности ребенка.
Данная книга посвящена решению одной из актуальных проблем - сенсорно-творческому развитию детей с расстройством аутистического спектра (РАС), организации занятий по художественно-творческому развитию, диагностике и мониторингу ряда важных свойств, проявляющихся в процессе работы с ними.
Книга адресована семье особенного ребенка, а также специалистам-педагогам, психологам, дефектологам, тьюторам, волонтерам и студентам профильных вузов, занимающихся коррекционной работой, художественно-эстетическим развитием детей младшего и среднего школьного возраста.

74.90
Б91
БУН ВИКТОРИЯ М. Воспитание ребенка с аутизмом : как помочь ребенку преодолеть трудности и преуспеть / Виктория М. Бун ; перевод с английского и редакция М. В. Курдюповой. - Санкт-Петербург ; Москва : Диалектика, 2022. - 155 с. - Библиогр.: с. 155. - ISBN 978-5-907458-71-0. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Воспитание детей с аутизмом - сложная и ответственная задача, которая ложится на плечи родителей. И каждый родитель, несомненно, хочет быть уверен в том, что, несмотря на круговорот повседневных дел и обязанностей, он делает все, что в его силах, чтобы обеспечить гармоничное развитие ребенка. В этой книге описаны терапевтические техники, эффективность которых научно доказана. Применяя данные техники ежедневно, можно помочь ребенку приобрести жизненно важные навыки и преуспеть. Автор книги, Виктория М. Бун, дает рабочие инструменты, которые помогут создать индивидуальный план по коррекции поведения ребенка с целью поощрить и закрепить положительное поведение и погасить нежелательное или проблемное. Используя стратегии, в основе которых лежат принципы прикладного анализа поведения, можно помочь ребенку с РАС достичь гораздо большего, чем могли бы предложить его родители. Эти стратегии и их применение подробно описаны в данной книге.

88.72
В75
ВОРМЕР КЕЙСИ. Мир глазами человека с аутизмом : принципы общения с людьми, имеющими расстройства аутистического спектра / Кейси "Ремров" Вормер ; перевод с английского и редакция М. В. Курдуповой. - Москва ; Санкт-Петербург : Диалектика, 2022. - 126 с. - Библиогр.: с. 125-126. - ISBN 978-5-907458-54-3. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Книга дает читателям информацию о том, как воспринимают мир люди с расстройствами аутистического спектра (РАС). Автор — человек с РАС, который делится своими наблюдениями и чувствами, показывает жизнь людей с аутизмом "изнутри". В книге есть базовая информация о расстройствах аутистического спектра, например, о том, что такое аутизм, когда он был впервые диагностирован, как проводится диагностика, и каковы основные симптомы аутизма у детей и взрослых. Кроме того, даны рекомендации о том, как эффективно выстроить взаимодействие с человеком с расстройством аутистического спектра в различных ситуациях, будь то школа, работа или же просто дружеское общение.
Если у вашего друга, родственника или коллеги расстройство аутистического спектра, общаться порой бывает непросто. Эта книга поможет найти общий язык, сделать взаимодействие понятным, содержательным и взаимовыгодным. Любой нейротипичный человек сможет овладеть искусством говорить (и слушать), используя советы экспертов и полезную информацию, изложенную в книге. Автор книги составил комплексное руководство, которое по праву считается надежным источником информации о нейроразнообразии, дает представление о расстройствах аутистического спектра и, кроме того, содержит основы стратегий эффективной коммуникации. Благодаря книге вы сможете избежать множества недоразумений, обнаружив свои предубеждения и избавившись от них.

74.3
Г718
ГОРЯЧЕВА ТАТЬЯНА ГЕРМАНОВНА. Расстройства аутистического спектра у детей : метод сенсоматорной коррекции / Т. Г. Горячева, Ю. В. Никитина. - Москва : Генезис, 2023. - 165, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 143-146. - ISBN 978-5-98563-534-8. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Диагноз "ранний детский аутизм" включает в себя огромный спектр разнообразных и сложно переплетенных нарушений, требующих особого подхода на каждом отдельном этапе развития ребенка. В пособии представлен метод сенсомоторной коррекции таких нарушений. Приведены комплексы сенсомоторных упражнений для различных групп детей с нарушениями аутистического спектра. В основу классификации аутистических нарушений положены периодизация психического развития и законы взаимодействия разных уровней психических процессов.
Пособие предназначено для нейропсихологов, дефектологов, психологов, педагогов, работающих с аутичными детьми, а также родителей этих детей.

74.90
Д131
ДАВИДОВИЧ ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА. Сказки для детей с расстройствами аутистического спектра : секреты успешной социализации / Полина Давидович, Анастасия Финченко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 62, [1] с. : ил. - (Особенные дети). - 0+. - ISBN 978-5-222-36681-3. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Эта книга написана в помощь родителям/специалистам, чьи дети/подопечные имеют диагноз "расстройство аутистического спектра" и направлена на развитие у детей с легкими формами РАС способности поддерживать социальное взаимодействие. Вы узнаете о возможностях коррекции таких детей и получите рекомендации для проведения продуктивных занятий с ребенком. Научив ребенка "считывать" эмоции у других и понимать свои собственные чувства, помогая ему полноценно и благополучно их переживать и выражать, мы открываем одну из дверей в большой мир для детей с РАС. Сказки в нашей книге познакомят особенного ребенка с миром эмоций и станут настоящей палочкой-выручалочкой для мам и специалистов. Каждая сказка сопровождается заданиями, которые с ребенком должны выполнять мама или специалист.

74.3
Д382
Дети с расстройствами аутистического спектра в детском саду : [с 1 до 8 лет : сборник] / составитель Н. В. Нищева. - Санкт-Петербург : Детство-Пресс, 2022. - 266, [1] с. - (Библиотека журнала "Дошкольная педагогика") (Разработано в соответствии с ФГОС). - ISBN 978-5-907540-36-1. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
В сборнике представлены материалы из опыта работы дошкольных образовательных учреждений России с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра. Это разработки для программного обеспечения образовательного процесса и психологического сопровождения детей, для социализации дошкольников с РАС, их речевого развития и другие методические материалы. Рекомендован педагогам и специалистам ДОУ.

74.3
И957
ИХСАНОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными дошкольниками / С. В. Ихсанова. - Санкт-Петербург : Детство-Пресс, 2021. - 205, [1] с. - (Разработано в соответствии с ФГОС). - Библиогр.: с. 189-193. - ISBN 978-5-89814-690-0. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
В книге обобщены теоретические и коррекционные подходы, принятые в отечественной и зарубежной специальной психологии и педагогике при оказании помощи детям с РДА (ранний детский аутизм). Предложены специальные психолого-педагогические задачи в работе с аутичными детьми в зависимости от группы (по классификации О. С. Никольской). Отражен опыт индивидуальной работы, а также работы в малых группах с детьми 1, 2, 3, 4 групп аутистического дизонтогенеза. Систематизированный по "жанрам" речевой стихотворный материал используется автором в коррекционной работе по формированию речевых и коммуникативных навыков с детьми 3-4-й групп аутизма. Практический материал может быть использован специалистами (психологами, педагогами-дефектологами, учителями-логопедами) как в коррекционной работе с аутичными дошкольниками (3-й, 4-й групп), так и с детьми, имеющими нарушения психического, речевого развития и эмоциональной сферы. Книга будет полезной родителям детей-аутистов.

74.3
К906
КУЛЬКОВА НИНА ЛЬВОВНА. Анатомия речи : как отстроить речь у детей с особенностями развития : уникальный путеводитель / Нина Кулькова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 120, [5] с. : ил. - (Особенные дети). - Библиогр.: с. 118-120. - 0+. - ISBN 978-5-222-37012-4. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Только в России более двух миллионов детей с особенностями в развитии, и большинство из них имеют речевые проблемы. Таким детям обязательно показана помощь логопеда-дефектолога. Однако участие родителей в работе над запуском и развитием речи всегда ускоряет этот достаточно длительный процесс, и эту роль сложно переоценить.
Если родители действительно хотят помочь своему ребенку и при этом не утонуть в ворохе специальной литературы, следует прочесть эту книгу. Автор простым и понятным языком рассказывает о сложной и многоступенчатой структуре речи, о причинах, которые мешают вашему малышу освоить речь, приводит рекомендации по диагностике и взаимодействию с ребенком. Это инструмент, который поможет понять действия логопеда и со знанием дела выполнять его рекомендации, чтобы особенные детки смогли заговорить.
Книга может стать уникальным путеводителем для "особенных" родителей в сложном путешествии к вербальному общению с их неговорящим пока ребенком. Она, несомненно, будет интересна и специалистам, т. к. поможет структурировать их собственные знания и опыт.

74.3
С603
СОЛОВЬЕВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ. ДЦП-Ангел : бережно о сложном : [реабилитация детей с ДЦП в домашних условиях] / Роман Соловьев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 129, [1] с. - (Особенные дети). - 0+. - ISBN 978-5-222-36801-5. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Дорогой читатель, если ты держишь в руках эту книгу, значит, тебе предстоит пройти серьезный путь с испытаниями. Но дорогу осилит идущий! Настройся на длительный марафон.
Нет абсолютно никакой волшебной таблетки в вопросе реабилитации при ДЦП, есть только способность увидеть потенциал и помочь ему раскрыться. В то же время чрезмерные требования подобны яду, в который превращаются лекарства. Обрети меру во всем. Должно быть адекватное восприятие реальности - без избыточной жалости, но в то же время без жесткости. Помимо формирования представлений о тренировочном и педагогическом процессах не забывай о расширении кругозора и о критическом мышлении.
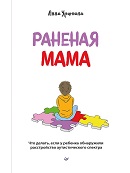
74.90
У738
УРЮПИНА АННА. Раненая мама : что делать, если у ребенка обнаружили расстройство аутистического спектра / Анна Урюпина. - Санкт-Петербург : Питер, 2022. - 351 с. - (Осознанное родительство). - Библиогр.: с. 342-351. - 16+. - ISBN 978-5-4461-1987-5. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Что делать, если врачи поставили вашему ребенку страшный диагноз, а в России такое не лечат? Что делать, если супруг сбежал, оставив вас наедине с горем? Что делать, если вы пытаетесь восстановить ребенка всеми доступными в нашем государстве способами, но денег не хватает? Время идет, а малышу ничего не помогает. Где взять силы и ресурсы? Как не провалиться в депрессию? Ответы на все эти вопросы вы найдете в книге "Раненая мама". Автор - мама двух особенных мальчишек - опровергает все существующие мифы и заблуждения об аутизме, делится своим личным опытом воспитания двух детей-инвалидов в одной семье.










